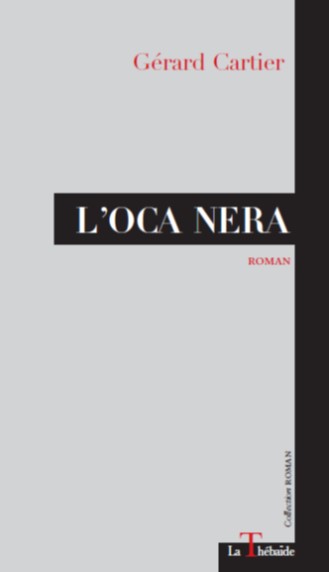|
|
 |
Aamon
|
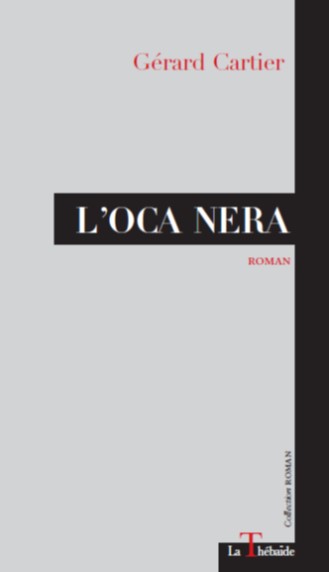 |
|
|
Ce "roman" en cours d'écriture, qui pourrait s’appeler Droit de suite, s’inscrira dans la continuité de L'Oca nera (La Thébaïde, 2019) et de son journal d’écriture, Ex machina
(La Thébaïde, 2022). Au milieu d'une tresse de récits, on y retrouvera
Mireille Provence, « l’espionne du Vercors », passant de prison en
prison après la commutation de sa peine de mort en travaux forcés à
perpétuité, et bientôt rendue à la vie courante par la Justice, qui est
parfois pitoyable aux pires criminels. On y apprendra aussi qui est le
mystérieux Oberland, son amant, qui présida la cour martiale de
Saint-Nazaire-en-Royans (une soixantaine de fusillés, des centaines de
déportés) – et, si les archives militaires du Blanc aujourd’hui
inaccessibles consentent à s’ouvrir, ce qu’il devint après la guerre.
Ces récits, qui s'inscrivent principalement dans les paysages sauvages
du Vercors, mêlent le présent au passé et la fiction à l’Histoire. L’Oca nera empruntait sa structure au jeu de l’oie, chaque chapitre figurant une case du jeu ; Aamon en reprend les titres en les réagençant – au hasard semble-t-il, mais qui sait...
Des extraits de livre en cours d'écriture ont été publiés, à intervalles mensuels, sur le site Remue.net : 1. Il paradiso (L'incendie de la Sacra) - 2. Le temps (Le capharnaüm) - 3. Le cauchemar (Le drame du Vercors, 1944) - 4. Le secret (Le huitième oncle) - 5. Le passé (Livia) - 6. Une bouffonnerie (Joséphine) - 7. La grotte des Fées (Fantômes) - 8. Les Vigilants de l'Apocalypse (Le système de la nature) - 9. Les trois poules de Mussolini (Les vies prodigieuses de Magda Fontanges) - 10. Les amours du crapaud (Un cours de philosopie naturelle) - 11. Prison pour femmes (Mireille Provence à Rennes) - 12. La Providence des sourds-muets (Un amour à la Libération) - 13. La forêt gaste (Le maquis) - 14. Fin de perpétuité (La libération de Mireille Provence) - 15. La folie en tête (La fin de Mireille Provence) -15. L'ultime brasier (Le crématorium).
Un extrait a été publié sur le site L'e-musée de l'objet : Le perroquet.
Dans le même cycle de L'Ornélie :
I. L'Oca nera (La Thébaïde, janv. 2019)
II. Ex machina (La Thébaïde, sept. 2022) : Journal d'écriture de L'Oca nera
III. Les amours de Loris (Al Manar, mai 2025) : Les poèmes d'Ornel Colomb
|
1. Il paradiso
Une lueur vacillante rougeoie à mi-ciel, ourlant d’une
écume légère la crête d’une montagne à peine découpée sur la voûte
nocturne par le pinceau d’une lune cachée, ou le halo des lumières de
Turin, un feu grégeois qui brasille sourdement en enflant peu à peu –
et tout à coup le piton du Pirchiriano s’embrase. Dans les villages de
la vallée, à Sant’Ambrogio, à Condove, et jusque dans les fonds de
Sant’Antonino, les rues donnant sur le mont sont bientôt envahies par
des grappes de badauds ébahis, certains en pantoufles, ou la serviette
autour du cou, quelques vieillards arrachés par les cris à leur premier
sommeil en pyjama de bagne malgré le froid qui pince, la plupart muets,
comme devant l’autel quand l’officiant ôte le voile et que le calice
apparaît, ou jurant entre leurs dents, incrédules, révoltés : la Sacra
brûle ! Des siècles en arrière, les bandes d’hérétiques qui pullulaient
dans ces montagnes, les bougres, les vaudois, y auraient vu la punition
de Dieu, l’enfer précipité sur les mauvais croyants, et peut-être,
pleurant sur leur seuil, quelques dévotes supplient-elles encore saint
Michel de les sauver et d’épargner le monument. Car ce n’est pas qu’une
forteresse, c’est le Cluny du Piémont, l’abbatia nullius du Nom de la Rose…
non seulement des murailles massives et des charpentes séculaires, mais
un dédale étagé de corridors, d’escaliers, de cellules nues et de
salles sonores où dort un capharnaüm de vieilles choses sacrées,
dorées, huileuses, piquées par les vers, des clôtures, des retables,
des anges peints au blanc d’Espagne, des châsses vitrées exhibant des
bouts d’os, des stèles latines, des surplis de dentelles, et des livres
par milliers, Saintes Bibles, traités des Pères de l’Église, Moralia in Job, antiphonaires, manuels d’oraison – et parmi eux peut-être, caché derrière les lourds vélins par un docteur honteux, Le Nom de la Rose
lui-même, où les aventures de l’esprit enfantent tous les crimes… et
non seulement cette brocante de bondieuseries, mais tout le passé,
toute l’Histoire piémontaise depuis Hugues le Décousu, les moines en
sandales à brides, les cavalcades en armures, les noces d’enfants de
douze ans, les processions royales dévalant à pas lents l’Escalier des
Morts, et le vol de la belle Aude aux bras de saint Michel, un
prodigieux maelstrom de passions et d’intrigues et d’élévation des âmes...
5. Le portrait
...nos vieux albums de Tintin aux dos reliés de toile,
aux pages malmenées par d’autres que nous, sans respect pour notre
enfance, même Le Lotus bleu,
même Le Lotus bleu,
dont je découvre avec dépit que la grande planche sur Shanghai (Dieu !
j’en ai passé du temps à rêver sur cette image, traduisant à ma façon
les idéogrammes suspendus dans les rues et courant la prétentaine…) est
maculée de grosses lettres charbonneuses ;
une pile de Journal de Tintin
: en l’absence des aventures du petit reporter, j’y lisais d’abord les
vies édifiantes racontées sur quatre pages de bandes dessinées – je me
souviens de l’inventeur de la science des nuages, cloué dans son lit
par un mal incurable, qui passa ses jours à regarder le ciel dans sa
lucarne, le contemplant d’abord comme font les enfants, pour les
créatures étranges qu’y dessinent les nuages, puis avec esprit de
système, notant leurs formes et leurs couleurs, leur donnant des noms
latins, en remplissant des carnets avec l’heure d’observation et le
temps qu’il faisait, et en déduisant peu à peu des lois… ou du célèbre
(célèbre en mon temps ; on ne l’apprend plus dans les écoles ; on a mis
l’Histoire en charpie en même temps qu’on la dépouillait de ces images
colorées qui constellent encore la mémoire des plus vieux, réductrices
sans doute, et fausses quelquefois, mais qui, en le rendant
puissamment sensibles, enseignaient mieux le passé, et quelques vertus
morales, que les leçons sévères) Bernard Palissy, qu’on voyait attaquer
à la hache son mobilier Henri IV (?) pour alimenter le feu qui menaçait
de faiblir, où il cuisait des plats émaillés de dragons et de fruits
adamiques...
8. Le secret
À la description de la ferme au noyer je reconnais
Carrue, où mon père est né. Le voilà le secret : Esprit est un frère de
mon père, un huitième oncle, que nous ignorions jusque-là. Tout à
l’orgueil de nous informer qu’il est né « le jour de la Saint-Esprit »,
qui lui a donné son nom à défaut d’autre chose, il oublie de préciser
l’année : aux alentours de 1925 – il était le dernier de la fratrie. Il
s’attarde avec complaisance sur son enfance, comme le ferait n’importe
qui, mais je n’en dirai rien. Lorsqu’on connaît la vie à la campagne et
la dureté de l’époque, elle n’a rien que de très banal, gouvernée par
le comput agricole et scandée de grandes fêtes, non les cérémonies
religieuses (on avait le cœur trop froid, là-haut, pour s’embarrasser
de sentiments pieux, faiblesse tout juste bonne pour les veuves et les
communiantes), mais d’interminables banquets au pied des granges
couronnant des besognes mythologiques, foins, moissons, gaulage des
noix, où les langues retrouvaient leur agilité et les cœurs
s’entrouvraient dans une débauche de sauces et de vins. Les enfants y
avaient leurs prérogatives, la conduite des animaux, et leur
récréation, l’école, gagnée à pied à travers les collines, où ils
apprenaient à lire dans des Morceaux choisis dépeignant leur propre
vie, les saisons des collines, les foins et les moissons. Plus tard,
Esprit voit ses frères partir à la guerre et en revenir, hormis mon
père, resté prisonnier quelque part en Allemagne. Début juin 44, quand
Radio Londres active les maquis et que des centaines d’hommes
impatients d’en découdre gagnent le Vercors, il quitte Carrue à la
nuit, passe l’Isère et rejoint ses trois frères qui y sont déjà, le
futur camionneur, le futur garagiste et le Marcel, qui se déclare
mécanicien. Comme eux, il est inscrit sur les rôles de l’entreprise
Huillier, un transporteur de Villard-de-Lans qui offre une couverture à
la Résistance.
10. La mémoire
À la via Appia. fuyant dans les siècles. un paysage au
noir de fumée. grands cyprès flexibles, pavés bossués. & des
tombeaux en ruines. HIC·SOROR···
À un nom sur le marbre en belles romaines. qui se dit à jamais Livia dans notre langue.
Aux
nuits de Turin. le râle au loin des derniers tramways. ses talons
claquent sous les arcades. les saisons passent dans un éclair. qui ne
nous sont qu’une seule.
Aux collines enfumées de San Vito. une
porte cloutée au bout d’une impasse. déchiffrant du doigt le portier.
5812. adresse secrète au visiteur nocturne.
V-8/1-2
Perché egli mostrò amarmi più di molto
io ad amar lui con tutto il cor mi
mossi1
À l’escalier dans les ténèbres. larges marches de
pierre usées. gravies par les noces, dévalées par les deuils. &
l’amant sur la pointe des pieds.
Au lit glacé où l’un fait pour l’autre le moine.
À une taverne cachée dans les arbres. L’Orto
già ou le Galateo.
partageant vin des Langhe et bagna
cauda. sur ma lèvre brûlée le bout de sa langue. partageant la
douleur. & dans les bois la joie.
[1] Car il témoigna m’aimer plus que beaucoup / moi de tout
mon cœur je me mis à l’aimer (L’Arioste, Roland furieux).
13. Le puits
Hormis quelques escapades musicales, de plus en plus
rares, la double infirmité de mon oncle le tenait à l’écart de la
société, et même de sa famille, qui après l’avoir écarté pour son
indulgence vis-à-vis de Vichy, avait fini par l’oublier, non moins que
s’il était étranger ou bien atteint de crétinisme. Dans ces collines
sévères, où l’on épousait à deux pas de chez soi, à côté des bancroches
et des goîtreux, la nature vous enfantait parfois l’un de ces meubles
humains qui, sous un regard d’eau trouble, n’étaient que bouche et
intestins, nourris de la même soupe que les chiens, déplacés de coin en
coin selon l’heure et la saison – au printemps, on en voyait parfois
devant les fermes, posés sur une chaise en paille, un béret de travers
sur l’arrière du crâne, placides, silencieux, passant leur journée à
sourire vaguement à Dieu sait quoi, adoptés parfois par un chien qui ne
leur voyait rien d’anormal, au mieux par une sœur aînée qui s’attachait
à eux par pitié, les choyant comme on fait d’une poupée, plus grande et
plus fragile, mais aussi docile et guère plus vivante –, qui
vieillissaient sans raison, vous gagnant l’indulgence du curé et la
clémence du Ciel, mais qu’on oubliait dans le compte de la famille. Le
désespoir avait saisi mon oncle. Il s’était tourné vers la magie,
peut-être influencé par Marie qui, malgré son métier, ou à cause lui («
…ces malades imaginaires que l’on convainc de leur maladie en la
nommant en latin, puis de guérir en leur faisant avaler un peu d’eau
sucrée… »), montrait une belle disposition aux pratiques occultes. Il
s’était souvenu de récits de guérisons instantanées au moyen de gestes
et de formules et une nuit de septembre, étant à La Cabane Bambou, il a
demandé à Marie de le conduire au bord d’un ancien puits de ferme qui
subsistait derrière le cabaret afin, lui dit-il, d’y précipiter son
mal. Devant la margelle, il a prié Marie de lui tourner le dos : les
sorcelleries, pour produire leur effet, ne veulent pas de témoin. « Le
temps de compter jusqu’à trois », Marie s’est retournée, traversée par
un pressentiment, au moment même où Esprit basculait dans le vide en
silence...
15. Une bouffonnerie
Pour l’ingénieur, jusque-là béni par le sort, ce fut
la fin de l’équipée. Le couple dut rentrer en métropole, suivi de dix
malles d’africaneries et accompagné par une créature qui fit sensation
dans les Terres Froides : une petite négresse à la peau luisante,
crépue comme un agneau, qui ne portait que du blanc et riait sans
raison à ceux qui l’approchaient. Elle se prénommait Tierce, mais de
L’Albenc aux Chambarans, on ne l’appela que Joséphine. On n’a jamais su
ses origines ; les commères locales, qui œuvrent à l’élucidation des
secrets de chacun, ont échoué à démêler son histoire ; mais elles en
ont tant rêvé, lui ont donné tant de naissances diverses, tant
d’attaches clandestines à ses bienfaiteurs, qu’elle semble issue de
cent géniteurs – un jeune palétuvier jailli d’un entrelacs confus de
racines. Tierce enfuie à vingt ans, son non-mari mort, l’ancienne
grande bourgeoise avait connu la gêne. Elle vivait dans une petite
maison grise au milieu d’un vaste jardin, presque en face de chez mon
oncle camionneur, seule au milieu de ses fétiches, dont elle énonçait
complaisamment les pouvoirs à Alice, qui s’abandonnait peut-être à
Dieu, mais savait aussi que le mal, quelque nom qu’on lui donne, prend
les formes les plus étranges pour nous atteindre. Un petit crocodile
empaillé dormait au mur de la chambre de Louise, trophée et mémorial –
un portrait par sympathie de son malheureux compagnon. Tous deux sont
aujourd’hui à Serre, dans la tombe de graviers qui jouxte celle de mes
parents, couchés sous un petit Christ anonyme. Sans la suite de
rencontres fortuites qui m’a conduit jusqu’à eux, nul n’en saurait plus
rien. Voilà, telle est ma tâche. Je suis une sorte de mormon voué à
sauver les morts. Non leurs noms seulement, Louise MACHON,
Gaston HAAS, mais avec les noms, qui ne sont
qu’accidents, un peu de leur vie – un amour, une folie, une épreuve ;
de simples images colorées, bien peu au regard de ce qu’ils furent,
mais lorsqu’ils paraîtront devant le Dieu Mormon, je veux dire
l’humanité future, si celle-ci a lu mon livre, peut-être, ayant aidé
d’autres à se connaître, à penser et à rêver, sera-ce assez pour
justifier leur vie.
18. La prison
Un an plus tard, en février 48, Mireille est à nouveau
emportée sur les routes. Elle parcourt la carte de France comme un jeu
de l’oie, passant de lieu en lieu au hasard des dés qu’un officier de
la Pénitentiaire, ayant tiré son dossier à l’aveugle parmi les piles de
cartons roses entassés sur son bureau, roule dans sa main avant de les
jeter sur son maroquin, la détenue passant alors de Pau à Mauzac, en
Dordogne, en enjambant Mont-de-Marsan, Agen et Eysses : un jeu de l’oie
aussi capricieux que le vrai, sinon que le pion est vivant et que
toutes les cases y sont une prison, sauf aussi qu’on le parcourt à
l’envers de la spirale du noble jeu, comme si, privés de leur volonté,
les détenus n’étaient soumis qu’aux forces naturelles, celles nées de
la rotation du globe, qui font tourbillonner les cyclones et torsadent
les fibres des arbres, à quoi l’on ne résiste pas plus qu’au mouvement
de l’Histoire. (...). Le rite du greffe se répète avec d’infimes
variations. Ici, elle se prénomme Julienne et elle est à présent sans
religion. Le compas la parcourt, médius, oreille, crâne – durant son
séjour à Pau, sous la pression des pensées qui bouillonnaient en elle,
sa tête s’est un peu élargie. Le greffier, qui n’est guère plus galant
que le précédent, note un point de varicelle sur sa tempe, qu’elle
cache sous une ondée de cheveux, et une déviation de son nez vers la
droite, que seul un œil exercé, ou la photographie, perçoit sur son
visage aux traits mobiles ; puis en face de son nom, en grands
caractères, il inscrit le mot MORT – celle à quoi elle croyait avoir
échappée, dont on la menace toujours. Un mois et demi plus tard, on la
ramène à Lyon, à disposition de la Justice militaire, qui a pris la
relève des Cours de justice.
25. Le Tre Galline
À Mauzac, Simone fait la connaissance d’une autre
espionne qui jouit d’un grand prestige auprès des prisonnières, et même
des gardiens, pour avoir été la maîtresse de Mussolini. Le greffe l’a
enregistrée sous le nom Madeleine Jeanne Corabœuf, mais ce bœuf
la révulse et, au contraire de l’espionne du Vercors, elle exige de ses
consœurs qu’on lui rende son nom de gloire, Magda Fontanges. Durant les
promenades, elle fait salon, une nuée de femmes autour d’elle, comme
des mouches attirées par la goutte de parfum déposée sur ses tempes (Joy,
de Jean Patou : un an de son pécule n’y suffirait pas ; comment se
l’est-elle procuré ?), les jeunes moucheronnes plus acharnées à la suivre,
vives et vibrionnantes, plus échauffées que les vieilles mouches à
bœuf, qui la soupçonnent d’affabuler. Ce n’est qu’un effet de sa
désinvolture ; elle se raconte à la diable, produisant sa vie au gré de
l’humeur, par fragments incohérents, mêlant les facéties de Fernandel,
les trois poules de Mussolini et des lits de luxe peuplés de malfrats,
digne de plusieurs vies simultanées, comme Padre Pio l’ubiquiste, en y
laissant par malice, ou par indifférence, bailler des silences que son
crédule auditoire imagine cacher d’indicibles turpitudes. Un jour,
harassée par ses jeunes consœurs, Magda raconte l’histoire des trois
poules de Mussolini qu’elles lui réclamaient en vain, excitées par le
prologue qu’elle leur avait malignement servi, impatientes de pénétrer
dans le harem du dictateur, qu’elles supposaient insatiable et dont, à
se souvenir de ses coups de menton au balcon du Palais de Venise, elles
imaginaient fiévreusement les coups de reins...
32. La maladie
Lui a-t-il suffi de tomber malade et de quelques
génuflexions dans la pénombre d’une chapelle pour voir ses crimes
pardonnés ? Une mention dans son état-civil m’a plus surpris encore ;
pour la première fois, sur la ligne Enfants,
est précisé : « 1 fils de 17 ans… » Un fils ! La graphie est nette, les
lettres pleines et déliées comme sur un cahier d’exercice, impossible
d’y lire autre chose. Pourquoi ai-je cru qu’elle avait une fille ?
Soumis à la question, aveuglé par les lampes, menacé de sévices, je
l’aurais affirmé mordicus ; j’aurais même pu donner son prénom : Agnès.
C’est ce qui m’a mis sur la piste de mon erreur ; c’est ainsi que dans Mensonges,
le ciné-roman publié après-guerre sous la signature de Mireille
Provence, se nomme la fille de l’héroïne… Combien d’erreurs ai-je ainsi
commises dans mon enquête, par manque de méthode, volatilité d’esprit
ou désir secret de l’aventure, me laissant à mon insu entraîner par
l’imagination jusqu’à modeler et colorer à mon goût l’ingrate réalité ?
Quoi qu’il en soit, je suis fâché de ce fils ; il détruit l’harmonie de
mes récits. J’ai été tenté de passer outre. Qui donc s’engouerait de
mon héroïne au point de parcourir la France et le Dauphiné pour
fouiller la dizaine d’archives où sont éparpillés les restes de sa vie,
qui saurait dénicher dans la jungle de leurs cotes arborescentes la
seule pièce dénonçant mon imposture ? Je crains que ce ne soit un très
vieux travers ; je n’ai jamais su résister à un mensonge brillant, même
enfant, au dépit de ma mère, qui m’enseignait la probité en m’obligeant
à les noter dans un « carnet de péchés » et en m’envoyant m’en laver
tous les mois dans la caisse à savon qui tenait lieu de confessionnal
au prêtre Jean. Mais j’ai pensé à Livia, que les falsifications de
l’Histoire indignaient et qui n’aurait pas voulu qu’aux gens et aux
faits du Vercors je change un détail, même par raison d’harmonie, et je
me suis repris. Inventer, quand on ne sait pas et qu’il faut recréer le
passé, passe encore ; mais mentir pour rien, dans une si mince
occasion, ce serait de la malignité. Ainsi en soit-il..
44. La cellule
D’elle, je sais presque tout, mais chaque découverte
amène un autre mystère, de plus en plus éloigné du centre du petit
univers qui a pour nom Mireille Provence, qui ne m’en attire pas moins
irrésistiblement. Cet automne, durant une nuit d’insomnie, j’ai cru
chasser les images désordonnées qui tourbillonnaient sous mon front en
dressant la liste des énigmes que j’aimerais élucider. Les voici en
vrac, telles qu’elles sont consignées dans mon carnet (...).
D’Oberland, qui est à mon héroïne bien plus qu’un
faire-valoir, il resterait aussi bien des choses à connaître. Ainsi,
passant de mystère en mystère, jetant au premier plan des personnages
secondaires, déployant villes et montagnes, traversant les époques sans
quitter tout à fait mon sujet, je pourrais construire un monde, une
jungle foisonnante hantée de spectres bigarrés, l’une de ces œuvres
monstrueuses qui terrifient les lecteurs, qui leur vouent pour cela une
admiration aveugle, un nouvel Ulysse, une autre Recherche du temps perdu,
courant la prétentaine sans me quitter jamais, seul véritable habitant
de ce dédale d’aventures, dont nul ne saurait démêler des factices les
véridiques… Vaucanson, l’illustre mécanicien, avait doté son canard
défécateur d’un foie qui se couvrait de graisse quand on nourrissait
l’automate, de sorte qu’avec son poitrail déformé, il tenait autant de
l’oie que du canard : hélas, je me reconnais bien là, je suis de cette
race, le frère de cet oiseau de Barbarie lourd et vaniteux qui se
gonfle à mesure qu’il se nourrit, lui de graines et moi de récits,
prenant des allures sauvages, rêvant comme lui de m’arracher au sol, et
tout pesant que je sois, et mesquin, et infirme, m’enflant aux
dimensions du siècle, jusqu’à faire de moi-même, par la vertu de mes
personnages, une manière de héros de roman, un Dom Colomb des Terres Froides…
Je ne me donnerai pas ce ridicule. Assez donc, assez. Je me retire dans ma cellule.