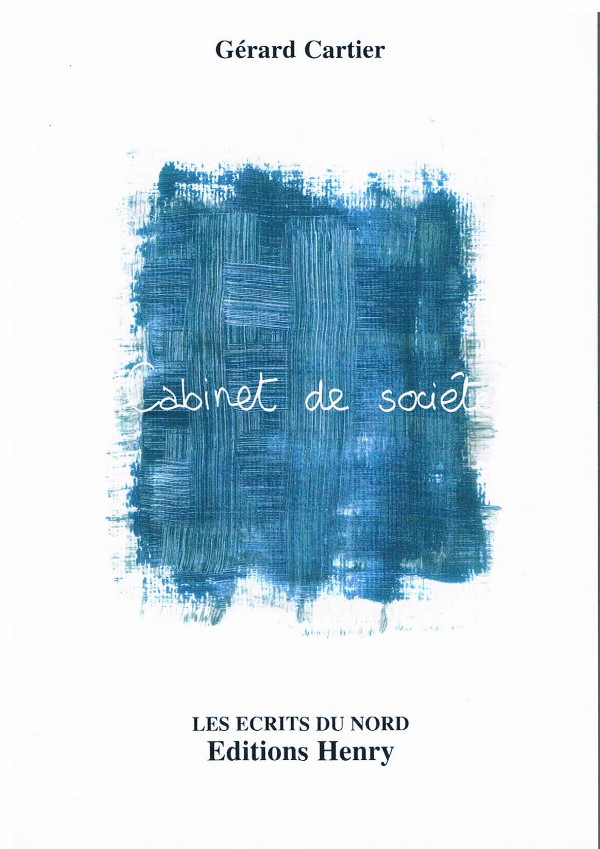Les
neiges de Slovénie
(Pierre Unik)
Ce n’était qu’un nom :
deux syllabes étrangères, arrogantes et sonores, comme
ces pseudonymes dont s’affublent les jeunes gens au moment de monter
sur les planches. Unik ! Nous ne savions rien d’autre. Il vivait
pourtant parmi nous, libre et ombrageux. S’il s’était
appelé Legrand ou Cartier, ne l’aurait-on pas déjà
oublié ?
Il était de cette époque broyée par la guerre dont
ne reste que le spectre sur de petites vignettes gélatineuses :
des collines pétries et repétries,
hérissées de vagues moignons carbonisés, une
glaise noire et suante à quoi rien, semblait-il, n’insufflerait
plus la vie. Ceux qu’elle enfanta pourtant, comment s’étonner
que leur cœur bouillonnât de colère ?
À peine sorti de l’enfance un formidable maelstrom l’aspire : la
littérature. Il est de ces apostats qui insultent l’ancienne
beauté, de ces talibans qui mettent le feu aux icônes et
brisent les statues ancestrales. Sept années d’un zèle
inflexible, à braver le monde du fond de l’arrière-salle
du Café Cyrano.
Il est le douzième apôtre, le plus jeune, celui qu’on
assied en bout de table et qui fait sa gloire des miettes du repas.
Celui qu’on donne aux basses besognes, qui aux coups de main se jette
le premier : des exécrations publiques, des expéditions
punitives, des rixes – Artaud, le désespéré,
giflé vivant pour une obscure querelle où les mots
faisaient tout... Qui se souvient de ce qu’il était à
vingt ans, peut-il beaucoup le blâmer ?
Il brûle un instant follement, puis s’évanouit. Sa vie
tient-elle dans ce maigre legs, cette liasse enveloppée dans un
gros papier bleu dont on dénoue fébrilement la ficelle,
quelques feuillets élimés, percés par les insectes
des saisons, qui frissonnent sur nos genoux, qu’un souffle suffirait
à disperser ?
Ce sont de ces songes où la main précède la
pensée, les vertes images d’une enfance chimérique : des
gants oubliés sur la mer et des alcôves de musique, tout
un monde bâti de théâtres, de souterrains, excessif
et merveilleux. Mais parfois, au milieu des collines arthuriennes, une
terre nue affleure, éventrée par la guerre, où
flotte la sueur des bêtes agonisantes.
Puis la main s’occupe d’autre chose, de caméra et de papier
journal. L’enfant prodige se tait. Il est aux prises avec le monde – plus rouge que l’iris noir. Sept
ans passent comme un souffle.
Rien n’a pu empêcher ce qu’on sentait obscurément venir.
On le jette aux avant-postes en Lorraine. Il dit le froid terrible, le
vent et la neige. Il dit les nuits qui dorment debout comme des
chevaux, et le pain qui ne dégèle pas. Nous qui savons la
fin, nous ne lisons que d’un œil. Comment s’empêcher de loucher
vers l’est ?
Et nous voici à mimer le travail du temps, poursuivant deux
pensées qui parfois, par bribes, coïncident. Sa page est un
palimpseste où sous les vers transparaissent des mots
émiettés, les traces d’un autre hiver enseveli sous les
neiges de l’an quarante, révélant non le passé
mais l’avenir. Et tant nous y mettons d’avidité, qu’on entend en
effet balbutier sous le gel une voix prophétique.
Il est en Silésie, chassé de stalag en stalag. Il est
à Schmiedberg, dans les ateliers de tissage, arcbouté
à de lourds chariots de bobines. Parfois, dans
l’entrebâillement d’une porte de fer aussitôt
refermée, des filles en haillons travaillant nu-pieds sur le
ciment, dans le galop des métiers mécaniques et la vapeur
du lin mouillé. Dans ce sombre am
stram gram, quel bonheur oublié ?
Le passé le happe. Il retrouve les odeurs de l’enfance, la laine
et le drap entassés dans l’atelier du tailleur polonais dont il
fut le fils. Il revoit les filles des cafés, la Seine dans la
nuit, et les boulevards comme des mots d’amour. Les jours passent en
somnambule.
À l’aube, une rue où l’on vend des funérailles. Gartenstrasse.
Il voit les boîtes qui leur sont destinées, qui
resserviront à d’autres après eux. Ses cheveux sont
blancs. Ses trente-cinq ans lui sont un linceul. Je n’aurais jamais cru la mort si
familière.
Il suce la rognure d’un crayon, luttant dans le froid pour retenir sa
pensée, poursuivant ce qui n’a pas de mots. Une poignée
de vers sur un cahier, dix pages encore, postées du stalag dans
le dernier hiver. Mais qu’importent ces vieux airs cadencés, ce ciel d’absinthe et ces bouquets de roses ? Un monde perdu,
découpé dans de vieux calendriers.
Et nous regrettons, au nom du désir que nous avons de l’aimer,
pour la souffrance endurée et la fin prochaine, la
déception qui nous étreint, comme si nous affligeait une
dureté de cœur. Mais les mots les plus purs, que valent-ils
devant l’esprit qui aspire la mort et refuse de se rendre ?
Dans l’est, à un jet de pierre, la montagne gronde.
L’armée rouge ! Il se jette dans l’hiver, traînant sous
lui son corps décharné. Des forêts dans le
brouillard, des neiges amoncelées. Son dernier compagnon recule.
Unik fait seul face au terrible désert. S’attacher à ses
pas, s’enfoncer sans carte dans ces monts gelés. Une Chartreuse
multipliée, composée d’instinct.
Il traverse des combes, des torrents, des rochers fendus. La neige
brûle dans ses savates. Ne pas dévier. Le vent qui fend la
chair. La faim qui se mesure un bout de pain glacé. Parfois,
tout près, l’aboiement d’une patrouille SS battant la montagne.
Parfois, très haut dans le ciel échancré, une
escadrille traçant une frontière mobile. Et la grande
ombre des Erzgebirge.
Le livre dit Slovaquie –
pourtant si lointaine – mais je lisais Slovénie,
obstinément, comme s’il fuyait Graz, et la neige chassée
en rafales en était plus sauvage. Je le vois errer dans ce pays
qui n’existe pas, les yeux fixés sur une fausse étoile.
Des nuits ont passé. Il titube, ivre de sommeil au milieu des
névés, les yeux brûlés, les mains
crevées, les pieds chaussés de glace. Il s’évade
pour toujours.
Tchécoslovaquie, toi qui as si longtemps englouti nos
poètes, avant que la malédiction ne t’emporte à
ton tour, Tchécoslovaquie où tout finit, quelle
mélancolie nous pousse encore vers toi ? Les neiges se
dissipent, le printemps déchaîne les torrents et
hérisse de couleurs la montagne : mais ceux que tu as
avalés, tu ne les rends pas.
Sa vie tiendra toute dans ce maigre tombeau, ce léger volume de
toile céruléenne à l’enseigne d’une femme-poisson.
Cent courtes pages rendues au jour après longtemps. Les passions
monstrueuses se sont dissipées, à peine si les mots se
souviennent encore, et le nom orgueilleux lui-même bientôt
ne sera plus. Qu’en serait-il, si l’hiver l’avait relâché,
lui qui n’avait encore que l’âge du milieu ?
in Cabinet de Société (Henry, 2011)
Version initiale in Faites entrer l'Infini n° 32 (déc. 2001)
Haut de page