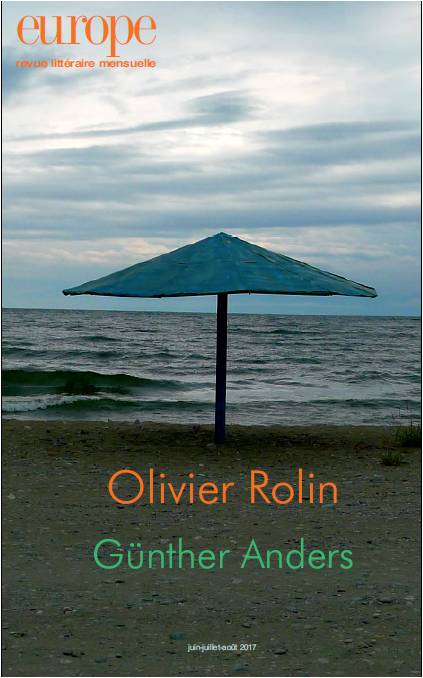|
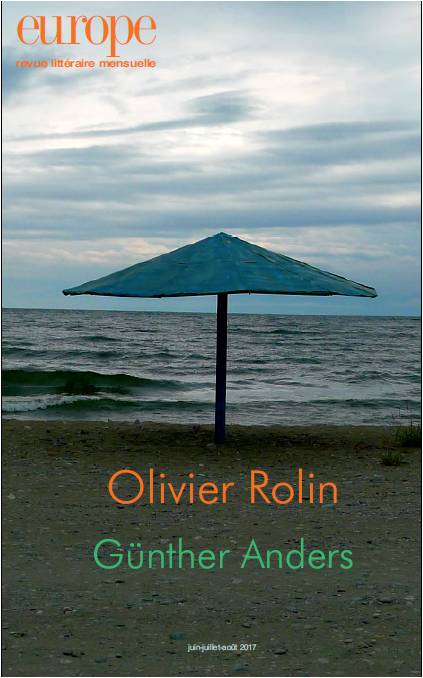 |
Invitation en Rolinie
Introduction au dossier Olivier Rolin
(Europe n°1058-1060)
|
 |
|
Les lecteurs nonchalants ont tendance à réduire
l’œuvre des écrivains à un ou deux romans – pour Olivier Rolin,
Port-Soudan et Tigre en papier. C’est non
seulement injuste, c’est
aussi très réducteur, comme le prouvent les deux gros volumes de ses
œuvres complètes publiées il y a quelques années sous le titre
générique Circus. Peu
d’auteurs français contemporains qui savent
composer un monde d’une telle profondeur de champ. Bien peu qui
possèdent un registre de thèmes et de langue aussi étendu. Très peu,
enfin, qui s’aventurent aussi loin des schémas du roman traditionnel.
Si son écriture est mobile (« elle doit s’adapter à son objet », dit-il
dans l’entretien qu’on lira plus loin), sa voix, très singulière, est
presque immédiatement reconnaissable. Je laisserai aux écrivains et
critiques qui ont accepté de participer à ce dossier le soin d’une
approche ordonnée et systématique de quelques aspects de cette œuvre
foisonnante, me contentant d’en définir les pôles et d’en présenter les
thématiques les plus importantes.
L’HISTOIRE est la grande affaire d’Olivier Rolin. « On écrit parce
qu’on est mal placé dans son époque. Parce qu’on s’y sent dépaysé
». L’Histoire à laquelle il s’attache est un archipel. De l’océan des
siècles émergent quelques périodes privilégiées où l’humanité, ou
plutôt ce qu’on nommait autrefois le peuple (vocable qu’on n’écrit pas
aujourd’hui sans une certaine hésitation), a cherché se rendre maître
de son destin. En France, la Commune de Paris (Un Chasseur de lions) ;
la Résistance et la Libération (le père de l’écrivain participa
militairement à la lutte contre le nazisme) ; et, bien sûr, mai 68
(Tigre en papier) : on connaît
le long engagement d’Olivier Rolin
(1967-1974) au sein d’un groupe maoïste, La Gauche prolétarienne, dont
il dirigea la « branche militaire », ce qui le contraignit à passer
dans la clandestinité – cet engagement, qui confine à la légende, fut
pour lui une expérience capitale qui, à défaut de l’écrivain, façonna
durablement l’homme. À l’étranger, une véritable fascination le ramène
sans cesse vers la Russie de la période soviétique ; outre de nombreux
textes dispersés, elle lui a fourni la matière de plusieurs livres et
récits (entre autres, il y a peu, Le
météorologue). Il s’agit toujours,
on le voit, de moments d’acmés historiques où une grande espérance
avorte, où une utopie généreuse accouche d’une tragédie ou, plus
banalement, de la désillusion – même la Résistance, qui se renie dans
les guerres d’Indochine et d’Algérie. Ce vertige de la défaite, cette «
énigmatique puissance de l’échec » nourrit une mélancolie
profonde, comme si Olivier Rolin portait encore, au-delà de ses années
militantes, « le deuil de la révolution ». Une nostalgie de
l’action qui change le monde (ainsi, au cours d’un débat, a-t-il confié
que « …ce qui serait complètement beau […] c’est d’être écrivain,
philosophe et soldat »), un rêve héroïque imprègne son œuvre,
sans jamais prendre les formes schématiques du politique, témoignant
plutôt d’une conscience historique qui, de nos jours, tend
malheureusement à s’effacer. Aucun de ses livres où, même en-dehors des
périodes de cristallisation révolutionnaire, l’Histoire ne soit
présente d’une façon ou d’une autre, contribuant au récit ou lui
composant un contrepoint harmonique – que l’on pense à l’aventure du
Général Gordon qui tenait le Soudan pour l’Angleterre, dont l’épopée,
tressée à l’intrigue de Méroé,
fournit au roman un arrière-plan
saisissant.
LA GÉOGRAPHIE, c'est-à-dire le monde réel, pour lequel Olivier Rolin
manifeste une curiosité insatiable. Hormis son premier ouvrage
(Phénomène futur), tous les
livres d’Olivier Rolin sont situés,
depuis
les courts récits rassemblés dans Mon
galurin gris, dont la scène est
limitée à un territoire étroit, une île, une ville, voire un bar,
jusqu’au vaste récit de L’Invention
du monde, où c’est la terre entière
qui est saisie dans le compas du narrateur ¬: ce « roman » est fait des
milliers d’évènements publics ou privés, futiles ou terribles, banals
ou extravagants relatés par les journaux de la planète datés d’un même
jour, celui de l’équinoxe du printemps 1989. Souvenons-nous qu’au
sortir de sa période d’engagement radical, Olivier Rolin réalisa des
reportages pour différents journaux (en particulier Libération et Le
Monde), parcourant la planète en tous sens, avec une
prédilection pour
les pays où l’Histoire s’écrivait – le Liban, l’Afghanistan, etc. S’il
ne se refuse pas à la description de la nature (qu’on lise par exemple
la belle peinture des bords du Nil à El-Khandaq ), sa sensibilité le
porte plutôt vers les paysages urbains et autres lieux modelés par
l’activité humaine, en particulier lorsqu’ils portent les stigmates du
passé. Dans cet esprit, à côté de ses grands livres, qu’on me permette
de manifester un penchant particulier pour les récits vagabonds de Mon
galurin gris, « petites géographies » où s’entremêlent tous les thèmes
qui lui sont chers. Le motif de l’errance fournit d’ailleurs une belle
métaphore de la manière d’Olivier Rolin : j’y reviendrai.
LA RUSSIE est la terre d’élection d’Olivier Rolin. Outre de nombreuses
évocations ponctuelles, il a consacré pas moins de cinq livres à la
Russie et aux pays de l’ancienne URSS – et je gagerais que d’autres
suivront. Aucun n’est un « roman » à proprement parler, avec ce que ce
mot suppose de fiction : récits de voyage (En Russie, Sibérie,
Baïkal-Amour), jeu avec le
hasard (Bakou, derniers jours),
enquête (Le
météorologue) ; peut-on inventer quand la réalité fournit une
matière
si riche et si terrible ? La Russie, c’est l’Histoire faite géographie.
Aucun pays où le grand dessein révolutionnaire ait comme là pris forme,
aucun où il se soit ainsi figé en une longue tragédie, aucun peuple qui
vive encore, comme le russe, « sous la dramatique tenture de
l’Histoire ». Cette terre couturée, scarifiée, imprégnée par le
passé, où subsistent dans le paysage, comme autant de récifs d’un autre
âge, d’immenses ouvrages et zones industrielles abandonnés à la neige
et aux vents, portant témoignage à la fois du dessein prométhéen et de
la défaite, cette terre guaste est celle qui répond le mieux au sens de
la beauté d’Olivier Rolin : « Le long du rivage s’étend à présent, sur
des kilomètres, un paysage dévasté, sinistre et magnifique. ». De
nombreuses pages témoignent de son attirance pour ces figures sensibles
de la faillite que sont les ruines modernes et les zones urbaines en
déshérence : sa conception de la beauté ne va pas sans une once de
désastre – en quoi il manifeste, dans le sillage de Baudelaire, le goût
moderne.
L’AMÉRIQUE LATINE est l’autre tropisme géographique de l’écrivain. Si,
comme le firent jadis les surréalistes, un chercheur facétieux
s’avisait de dresser une mappemonde sur laquelle chaque pays occuperait
une surface proportionnelle à sa place dans l’œuvre d’Olivier Rolin
(l’idée n’est pas aussi incongrue qu’il y paraît ; l’homme a la passion
des cartes et a consacré plusieurs textes à la cartographie –
sans parler de L’invention du monde,
où c’est le globe terrestre
lui-même, « cette grosse boule historiée, bruissante de contes,
blasonnée de tableaux pittoresque… », qu’il fait tourner
fiévreusement sous nos yeux), au-delà du monde curieux qu’elle
donnerait à voir, ce planisphère sentimental condenserait éloquemment
son univers. L’essentiel des terres y serait rassemblée sur deux
continents : l’immense espace de la Russie et de la Sibérie et, aux
antipodes, l’Amérique latine, dont Olivier Rolin a parcouru à peu près
toutes les parties, du Mexique (Veracruz)
à la Terre de feu (Un
Chasseur de lions). Étrangement, son amour pour la langue
espagnole,
très sensible dans son œuvre, ne l’a pas porté vers l’Espagne, autre
pays de tragédie, mais vers ce continent excessif qui, plus qu’un lieu
d’Histoire (qu’il est aussi), semble être pour lui la terre des
passions.
L’AMOUR PERDU. Tout lecteur d’Olivier Rolin aura été frappé par
l’insistance d’un thème pourtant traité le plus souvent avec une grande
retenue : la perte de la femme aimée. Celle-ci prend des traits assez
divers selon les ouvrages. Elle joue un rôle important dans les deux
romans jumeaux que sont Port-Soudan
et Méroé, mais elle apparaît
également, de façon plus allusive, dans beaucoup d’autres – et
récemment encore dans Veracruz.
La grande discrétion de l’auteur (« Je
ne vois rien à ajouter qui ne soit futile ou indiscret », écrit-il en
conclusion d’une brève autobiographie ) ne permet pas d’en préciser la
charge intime. Peu importe, d’ailleurs. Avec Olivier Rolin, on est à
cent lieues des déballages intempestifs à quoi se livrent certain(e)s
tenant(e)s de l’autofiction – ce qu’on a nommé ainsi à tort, la fiction
en étant le plus souvent absente et, avec elle, la liberté d’invention
(et même de pensée) qui est l’un des sels les plus piquants de la
Littérature. Notons seulement que cette nostalgie secrète vient
s’ajouter à la mélancolie historique d’Olivier Rolin, contribuant à
donner à ses pages leur tonalité si particulière.
LE NARRATEUR. De même qu’ils sont situés, tous les livres d’Olivier
Rolin sont incarnés – écrits à la première personne : « …l’écriture est
le moyeu d’un monde insaisissable. C’est pourquoi je m’autorise à dire
je, l’étant finalement si peu » (si la voix qu’on entend dans
Tigre en papier se dissimule
sous un tu, ce tu équivaut manifestement à
un je). Ce narrateur présente la plupart des traits de l’auteur, y
compris dans un ouvrage proche du modèle standard du roman comme Méroé,
(ainsi, entre autres, de certaines confidences de l’écrivain sur son
adolescence), sans pourtant s’y ajuster totalement, même quand la
matière est autobiographique. Qu’on pense à Tigre en papier, dans
lequel l’expérience vécue au sein de la Gauche prolétarienne, qui
constitue le substrat du roman, est retravaillée, raffinée,
complexifiée et mise en perspective jusqu’à lui donner une portée autre
que celle qu’elle avait dans le temps de l’action. Au-delà des données
biographiques, somme toute contingentes, un trait d’écriture rapproche
plus fondamentalement le narrateur de l’auteur – pour autant que je
puisse l’appréhender. La retenue évoquée plus haut à propos de l’amour
perdu se manifeste à d’autres occasions par une allure bien
particulière dans l’expression de la pensée et des sentiments. Les
émotions trop intimes, les idées qui pourraient sembler définitives
sont souvent aussitôt révoquées en doute, dépréciées ou contrariées par
une incise, une boutade (l’autodérision est l’un des principaux
ressorts de cette figure) ou un commentaire en bas de page , comme si
l’écrivain craignait de se duper lui-même – mais le premier mouvement
reste écrit sur la page. Dans ces hésitations, ces réserves, voire
cette désinvolture, il est loisible de lire, pour ce qui concerne les
idées, la crainte de retomber dans les travers d’autrefois (les
certitudes aveugles, l’absolutisme souverain du politique), souvenir
qui nourrit une méfiance vis-à-vis de toute forme de rangement de la
pensée – ce qui ne signifie ni désintérêt pour le cours du monde ni
désengagement. Cette réticence rejoint, sur un autre versant, une
pudeur naturelle (ou est-ce, ici encore, une séquelle de cette période
ancienne où « l’individu nous semblait négligeable, et même
méprisable » ?) qui tient l’égo à distance et bride l’expression
des sentiments. Il en résulte un ton très personnel qui, mieux qu’un «
style », est la signature d’Olivier Rolin. Un exemple entre mille, en
ouvrant Circus 2 au hasard :
« La beauté est un arc électrique. Nous
voilà bien avancés ».
LA LITTÉRATURE est, avec l’Histoire et la Géographie, le troisième pôle
du triangle magique qui structure l’imaginaire d’Olivier Rolin. Comme
l’Histoire, pour les mêmes raisons, parce que toutes deux donnent sens
et profondeur au monde, la Littérature lui fournit un système constant
de références. Il a consacré aux écrivains de nombreux articles et
récits, en particulier ceux rassemblés dans Paysages originels
(Hemingway, Nabokov, Borges, Michaux, Kawabata). Au-delà des pages qui
leur sont consacrées, leur présence, explicite ou secrète, est quasi
permanente. Elle va bien au-delà d’un simple jeu d’échos. La culture
littéraire d’Olivier Rolin, qui va d’une connaissance intime des
Anciens (L’Iliade l’a marqué
au point qu’il a pu écrire, à propos de
son engagement maoïste : « …tu ne serais pas parti ainsi, absurdement,
à l’assaut des casques et des boucliers, si tu n’avais pas lu L’Iliade
»), jusqu’aux classiques russes du XXe siècle (Varlam Chalamov, Vassili
Grossman) et à la littérature française contemporaine (il fut vingt ans
durant conseiller littéraire au Seuil), – sans oublier Tintin ! –,
cette culture littéraire vaste et éclectique nourrit tous ses récits,
lui prêtant parfois des situations (ainsi de la roue Ferris
d’Au-dessous du volcan qu’on
retrouve dans plusieurs de ses livres) ou
des interprétations, mais aussi, plus fondamentalement, organisant sa
perception du monde. La réalité, dans sa complexité, est comme révélée
par le fait d’entrer en résonnance avec l’œuvre d’écrivains qu’il
admire. De même que l’Histoire, (elle n’est d’ailleurs qu’une des
formes de la médiation avec le passé), la Littérature « configure
l’expérience » : elle participe à la perception du monde, à
l’entreprise de déchiffrement du réel dans sa diversité, sa
versatilité, son ambigüité .
Je souligne ce mot, qui me paraît
emblématique de la pensée d’Olivier Rolin dans ce domaine ; il signale
parfaitement ce qui fait la spécificité des œuvres littéraires au
regard d’autres ouvrages de la pensée, en particulier de politique et
de philosophie. Les courts essais de Bric et broc consacrés à ce sujet
sont au demeurant des monuments de clarté, de souplesse et de
pertinence – preuve que la critique littéraire ne perd rien à
s’abstraire du jargon.
Le VAGABONDAGE est la forme
par excellence d’Olivier Rolin. Même dans
ses « petites géographies », même quand le cours du livre est dicté par
la circonstance (les étapes du transsibérien par exemple ), il ne se
contente jamais de promener un miroir le long de son chemin – ou
plutôt, le monde qu’il donne à voir est composé de multiples strates :
les manifestations du monde sensible s’enracinent dans un terreau
complexe fait d’évènements passés, de savoirs, de réminiscences de
lecture, de souvenirs intimes, etc. Il pourrait y avoir une ivresse à
errer ainsi parmi les paysages, les époques et les livres ; mais, pour
cet éternel voyageur, le voyage n’est « qu’une feinte, une fanfaronnade
philosophique » : malgré sa défiance à l’égard des idéologies, il
ne renonce jamais à tenter d’appréhender le monde par la raison. Il
distingue d’ailleurs une littérature symptomatique,
qui se contente de
mettre en scène les signes de l’époque (production qui, écrit-il, tend
« à masquer tout le champ du contemporain »), et une littérature
diagnostique, qui manifeste «
discernement et jugement ». Il en résulte
des récits capricieux, semés de rappels historiques, de réflexions
personnelles, d’allusions littéraires, de digressions, « bifurcations,
détours, fourvoiement » qui répondent à une esthétique du
discontinu, du montage, à une « logique du fragment et de
l’hybridation » caractéristique de la sensibilité contemporaine.
L’INVENTION. Olivier Rolin n’aime pas se répéter. La plupart de ses
livres sont l’occasion d’expérimenter une manière ou une forme
nouvelle. Bien peu où il n’y ait une ruse dans la démarche, une
invention dans la construction, une trouvaille dans le style. Il y a
parfois chez lui quelque chose de perécien – il a d’ailleurs conçu
Suite à l’hôtel Crystal sur
une idée de l’auteur d’Espèces
d’espaces :
décrire les chambres d’hôtel qui l’ont hébergé ; ce qu’il ne s’est pas
contenté de faire, insérant ces représentations dans un dispositif de
récits emboîtés : tout d’abord les histoires abritées ou suscitées par
les lieux, qui entretiennent entre elles des jeux d’échos ; ensuite les
commentaires du narrateur dans des notes en bas de page ; enfin
l’aventure du manuscrit, révélée par les notes de « l’éditeur »
supposé. Les deux derniers ouvrages d’Olivier Rolin témoignent à
nouveau de la grande mobilité de son écriture. Veracruz est un roman
hybride où l’aventure du narrateur (la disparition soudaine d’une femme
aimée) est suivie par les monologues de quatre personnages dont les
liens avec l’héroïne restent incertains et qui semblent composer une
histoire tout autre, diptyque conclu par des chapitres qui mettent
l’ensemble en perspective et en questionnent le sens : une construction
qui se refuse à la complétude, en une sorte de « rébellion contre
l’harmonie », selon le mot d’Adorno. Quant à À y regarder de
près, il s’agit d’un recueil de minutalia, descriptions d’objets
ou
minimes créatures (galet, asperge, huitre, etc.), dans le sillage du
Parti pris des choses de
Ponge, mais d’une visée et d’une facture
sensiblement différentes. Ces portraits, à la fois exacts et
fantasques, qui mettent en jeu toutes les ressources du langage et
foisonnent par analogie, sont aussi une lutte avec les mots : « On ne
voit vraiment que lorsqu’on a trouvé les mots ». Citation
qui me
fournit une belle conclusion à cette présentation.
Qu’on me pardonne le caractère sommaire de ces notes (il aurait aussi
fallu parler de sa conception du style : « une agitation, une vive
circulation d’un milieu, d’un état de langue à un autre » ; de
son ironie presque constante, protéiforme, qui ne dédaigne pas à
l’occasion d’aller jusqu’à la bouffonnerie ; de la richesse de sa
langue) qui ont pour seule ambition de donner aux lecteurs d’Europe qui
en auraient une vision partielle quelques clefs pour appréhender
l’œuvre d’Olivier Rolin, et à ceux qui ne la connaîtraient pas, l’envie
de la découvrir.
Gérard Cartier
- juin 2017