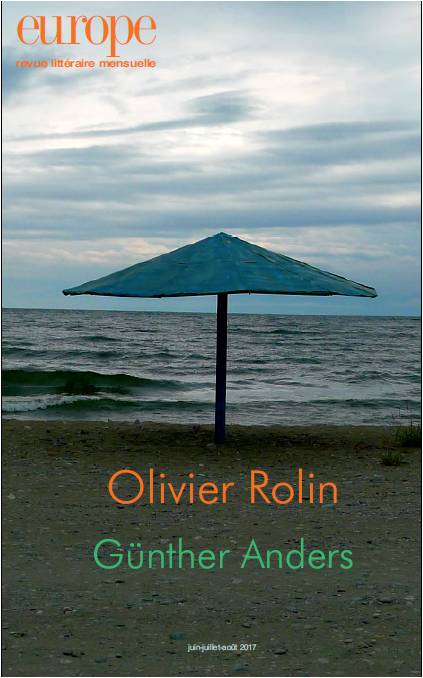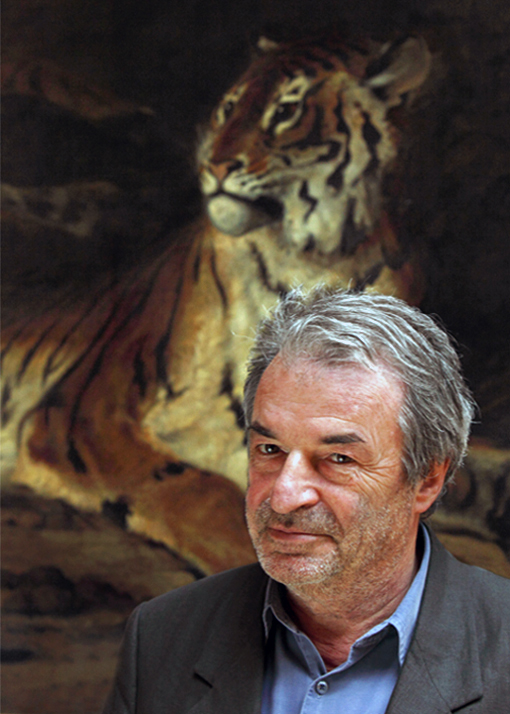|
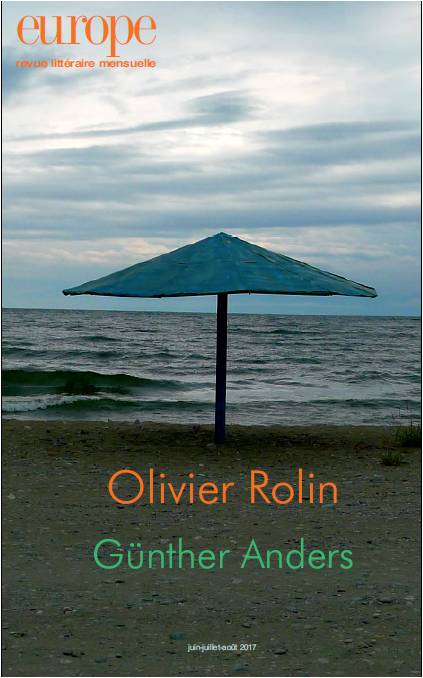 |
L'éloignement
Entretien avec Olivier Rolin
(Europe n°1058-1060)
|
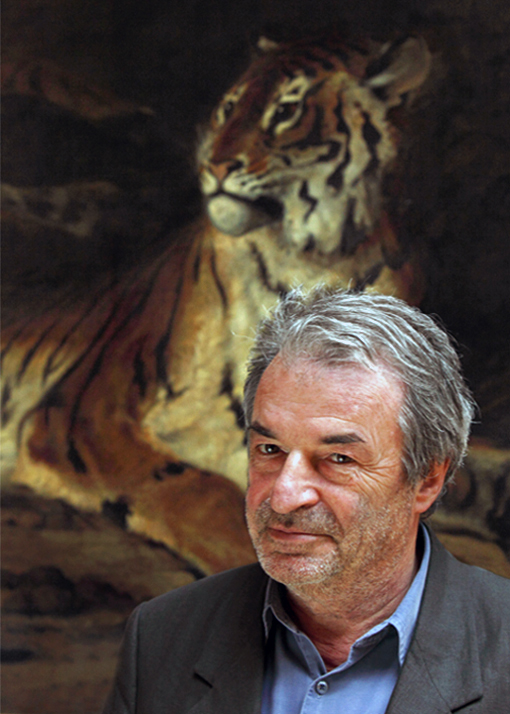 |
|
Gérard CARTIER –
L’écriture n’est venue qu’après une longue période (1967-1974) de
militantisme politique. Vous avez participé à la création de la Gauche
prolétarienne, un parti maoïste, et vous y avez exercé des
responsabilités importantes qui vous ont conduit dans la clandestinité
– vous étiez responsable de sa « branche militaire ». Vous avez rendu
compte de cet engagement radical bien des années plus tard, de façon
romancée, dans Tigre en papier. Cette expérience « énorme et
bouleversante » vous a marqué durablement. Comment a-t-elle nourri
votre imaginaire et en quoi a-t-elle été formatrice pour votre activité
d’écrivain ? Pourquoi vous a-t-il fallu tant d’années pour parvenir à
l’évoquer de façon directe ?
Olivier ROLIN – D’abord, deux petites précisions
que
me suggère la formulation de votre question : la Gauche prolétarienne
n’était pas un « parti », ne s’est jamais pensée comme telle (on
n’était pas encartés, on ignorait notre nombre, on était hostiles à
l’idée d’ « avant-garde », etc.). Il y avait tout de même quelque chose
de philosophiquement subversif dans notre aventure. Et l’ironie
m’oblige à dire que « branche militaire » est un bien grand mot. Disons
que je m’occupais des mauvais coups…
Pour répondre à votre question : cette expérience a été, sinon
formatrice de mon activité d’écrivain, en tout cas directement à son
origine, puisque mon premier livre, Phénomène
futur (ainsi nommé en
référence au poème en prose de Mallarmé), a été ma façon à moi
d’essayer d’y réfléchir. Je l’ai déjà dit ailleurs (c’est une formule
que je serai sans doute amené à utiliser plusieurs fois au cours de cet
entretien ; à mesure que le temps passe, le risque croît de se répéter
– non qu’on devienne gâteux, seulement parce qu’on s’est beaucoup
exprimé, et qu’il n’y a pas forcément de raison de changer d’avis d’une
fois sur l’autre), je l’ai déjà dit ailleurs, donc : je n’ai pas à
proprement parler choisi le roman, l’écriture romanesque s’est
lentement imposée à moi parce que c’était la seule qui pouvait exprimer
les pensées confuses, et souvent contradictoires, que je formais sur
cette expérience. Et là il y a peut-être quelque chose de formateur, en
effet (mais c’est une formation paradoxale, ironique) : penser quelque
chose sur la certitude suppose l’apprentissage de l’incertitude. Pour
le dire autrement : j’ai d’emblée découvert que le roman « n’est jamais
arrogant, terroriste » (Barthes), qu’il est « le territoire où personne
n’est possesseur de la vérité » (Kundera) parce que, venant de
l’arrogance et de la terreur, j’avais besoin du doute et de l’ambiguïté
pour réfléchir à cette expérience assez bouleversante en effet.
(Inutile de préciser – enfin si, utile tout de même – que ce que je
nomme ici « terreur », soit l’alliage d’une affirmation politique
extrême avec un usage limité de la violence, a bien peu de chose à voir
avec le sens que ce mot a pris récemment.)
La forme romanesque s’est imposée à moi parce qu’elle n’imposait rien,
justement – même pas la cohérence. Cette « conversion » est passée par
des médiations, naturellement. Entre autres la lecture des Démons
(qu’on appelait alors Les Possédés).
Tout récemment, je recherchais des
passages sur le nihilisme dans un vieux Folio tout jauni, qui date de
1974 – l’année de la dispersion de la GP -, tout plein d’annotations
souvent naïves, et je me suis souvenu – je l’avais un peu oublié -
combien ce livre avait été important pour moi.
GC – Vous avez
écrit
dans Bric et broc : « La politique range (…), le roman dérange
».
Pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer par le roman plutôt que par
l’essai ou la philosophie, ce qui aurait été plus naturel au regard de
votre formation (Normale Sup) et de l’expérience dont vous venez de
parler ? Est-ce parce que ces deux disciplines, elles aussi, « rangent
» ?
OR – Oui, c’est un peu ce que je viens de dire.
C’est
à partir d’une débâcle que j’ai commencé à écrire. Il me fallait donc
trouver une expression adaptée à cet état d’incertitude ou de «
dérangement » dans lequel j’étais plongé. C’était vraiment un esprit en
lambeaux qui essayait de s’exprimer. « La rage de vouloir conclure » en
laquelle Flaubert voit « une des maladies les plus funestes et les plus
stériles qui appartiennent à l’humanité », j’en venais, j’étais
vacciné. Il me fallait, pour continuer à penser un peu, passer par une
expression « inconclusive », si je puis dire. (J’ai parlé de l’état
dans lequel « j’étais plongé » : il serait plus juste de dire « nous
étions plongés », car j’ai du mal à dissocier mon cas de celui de mes
camarades de l’époque ; la dissociation intervient plus tard, chacun
cherchant à tâtons son chemin pour sortir du trou… pour moi, donc, ce
fut la littérature, qui a été véritablement, comme je l’ai écrit
quelque part, je ne sais plus où, ma « sortie d’Égypte »).
GC – Après la
dissolution de la Gauche prolétarienne, et plusieurs « années de
démolition », pour reprendre votre expression, vous avez fait du
journalisme (Libération, Le Monde, Le Nouvel Obs),
ce qui vous amené à
beaucoup voyager, y compris dans des pays troublés : le Liban,
l’Afghanistan, etc. Cette curiosité passionnée pour le monde, cet
intérêt pour les soubresauts de l’Histoire se manifestent dans presque
tous vos livres. Par contraste, la France contemporaine est presque
absente de votre œuvre, hormis dans Tigre en papier. Pourquoi ?
Est-ce
parce qu’elle n’est plus une terre d’épopée ?
OR – Oui, il y a sans doute de cela, au moins au
début. Et je me sens très loin du roman sociologisant, ou pire encore,
éditorialisant, dont on raffole en France. Il faut parler, n’est-ce
pas, des « sujets de société »… Mais je veux dire aussitôt (et, étant
donné ce qui précède, vous n’en serez pas étonné) que je suis bien loin
de pouvoir tout expliquer des raisons qui me poussent à écrire, et à
élire tel ou tel territoire d’écriture. Alors, tentons des hypothèses :
écrire répond au début à un désir de sortir du carcan des certitudes
politiques, et aussi de « m’en sortir », tout simplement. C’est une
démarche d’éloignement, un mouvement centrifuge. L’errance géographique
est peut-être la métaphore de cet éloignement. Elle serait le symptôme,
la trace d’une inquiétude (je
rappelle l’étymologie : intranquillité,
non-repos, inaptitude à trouver sa place) qui ne cherche pas à être
apaisée. C’est Barthes encore qui le dit : écrire, c’est faire
sécession. C’est un fait : je ressens le besoin (mais l’angoisse aussi)
d’être loin. Peut-être, par une curieuse translation, l’espérance en
l’avenir se transforme-t-elle en curiosité pour le monde, la dimension
du temps se convertissant en celle de l’espace. Mais il y a encore le
fait qu’être loin, c’est être jusqu’à un certain point détaché (« les
péninsules démarrées »…) : de son lieu d’origine, bien sûr, mais aussi
de ceux qu’on élit provisoirement (l’Amérique du sud, le Soudan, la
Russie…). Si j’écrivais sur la France, il se pourrait que le démon de
l’affirmation, la passion démonstrative, me ressaisissent. Être un
curieux, un passant intéressé, un observateur scrupuleux mais distant,
me convient assez.
Mais je pourrais aussi vous répondre par le vers fameux de Cendrars : «
Quand tu aimes il faut partir »… Enfin, vous voyez, tout ça n’est pas
très clair.
GC – Un grand
nombre
de vos livres sont des récits vagabonds fortement inscrits dans une
réalité géographique (Mon Galurin gris, qui rassemble une
trentaine de
courts récits, est d’ailleurs sous-titré Petites géographies).
Hormis
le premier, Phénomène futur, on peut en dire de même de vos
romans. Cet
ancrage dans une réalité précise, vérifiable, est-ce par souci de
vérité ? Ou en avez-vous besoin pour mettre en mouvement votre
imagination ?
OR – Oui, je crois que j’ai besoin de cette
inscription dans le réel (dans la géographie, la topographie). Je ne
crois pas avoir ce qu’on désigne généralement par ce stéréotype : « une
imagination débordante ». Chez moi, non, ça ne déborde pas. En
revanche, j’ai un goût très prononcé pour les cartes (les cartes
géographiques, pas les cartes à jouer). J’en possède beaucoup, c’est la
seule chose (avec tout de même des cadeaux pour des amies) que je
rapporte de voyage. On ne sait pas très bien pourquoi ni comment la «
machine à écrire » se met en marche, mais pour moi il semble que ça
commence par une accumulation de notes sans propos avéré. De cette
sédimentation plus ou moins continue (pas assez) de petites esquisses
descriptives, recherchant l’exactitude, il arrive que se dégage,
presque subrepticement, un projet littéraire. D’autres fois le projet
vient d’abord, mais alors j’ai besoin en effet, pour le faire vivre (et
tout simplement pour commencer à y croire), de l’étoffer de beaucoup de
« notes de terrain ». Il y a ainsi beaucoup de projets qui ne se sont
jamais développé, faute de franchir cette étape de « vérification » (le
monde souterrain, le naufrage du paquebot Costa Concordia…), et
évidemment bien plus encore de notes qui n’ont jamais débouché sur un
projet littéraire (des dizaines de carnets).
GC – S’il est
loin
d’être exclusif (vous marquez aussi une prédilection pour l’Amérique
latine), vous avez un très fort tropisme pour la Russie et les pays de
l’ancienne URSS. Qu’est-ce qui vous attire ? Que doit cette attraction
à l’Histoire – à l’utopie du socialisme, à la tragédie du stalinisme –,
et à la mélancolie historique que ces pays semblent incarner (vous avez
parlé, dans Méroé, de « l’énigmatique puissance de l’échec ») ?
A
contrario, la Chine est étrangement absente de votre œuvre…
OR – Oh, c’est une histoire compliquée, dont je me
suis un peu expliqué à la fin du Météorologue,
notamment. Il y a la
dimension géographique : pays immense, de loin le plus vaste de la
planète. « Le grand large sur Terre », ai-je écrit (et je suis un peu
marin). Pays de l’espace, prostor.
Voir comment cette réalité non
substantielle s’inscrit dans le paysage physique et même humain
(Jean-Christophe Bailly parle très bien de ça dans un texte qui
s’appelle « La pierre que la Russie a jetée en moi »). Ceux qui
s’ébaubissent devant les « grands espaces américains » n’ont qu’à aller
se frotter à la Sibérie… Pays qui était interdit dans ma jeunesse. Pays
paradoxal, insaisissable : quand on est à Vladivostok, est-on en Asie ?
Encore en Europe, en dépit des coordonnées géographiques ? Il y a la
dimension historique : c’est le pays de ce que j’ai appelé (dans Le
Météorologue toujours) « la dernière épopée des temps modernes
», « la
plus grande espérance profane qui fut » : la révolution, le monde
changeant de base, comme dit L’Internationale,
et c’est aussi le pays
où cette espérance fut atrocement trahie, défigurée, assassinée. Ces
deux dimensions se nouent : l’espace russe, ai-je encore écrit (désolé
de me citer…), c’est l’espace des morts innombrables que recèle la
terre russe. La Russie, c’est « l’île des morts », pour reprendre le
nom d’un tableau célèbre de Böcklin : une île immense, ou plutôt un
archipel… C’est un pays mélancolique, en effet, vous avez raison. Des
steppes, l’immense répétition de la forêt, le froid, un pays à moitié
en ruine. À cela s’ajoute le goût que j’ai de la langue, de la
littérature russes. Et peut-être aussi une touche d’esprit de
contradiction : c’est un pays si mal aimé qu’il ne me déplaît pas
d’essayer de l’aimer (ce n’est pas toujours facile)…
La Chine ? D’abord cela ne fait pas si longtemps que je la fréquente.
Peut-être son heure viendra-t-elle pour moi ? Mais ce n’est pas sûr –
trop de gens là-bas, trop d’évidente réussite, de puissance, trop
d’avenir… Peut-être aussi la Chine réelle a-t-elle du mal à «
surimprimer » la Chine imaginaire de ma jeunesse… (Je dis ça, mais en
fait je ne le crois pas.)
GC – Dans Mon
galurin gris, vous avez écrit : « La Terre est comme le vaste blason
bigarré de nos passions ». À ce propos, dans un entretien avec vous
pour la revue Secousse, je vous ai posé la question : « Voyagez-vous en
moraliste ? » Le mot, même au sens des classiques, a semblé vous gêner.
Que cherchez-vous dans le voyage (et dans la littérature), au-delà de «
la connaissance des hommes et de soi-même », selon la formule consacrée
?
OR – Ah, je ne me souviens plus de cette gêne, mais
il
est vrai que je ne comprends toujours pas très bien cette question
ancienne. Il y a des mots dont je n’ai jamais très bien su ce qu’ils
voulaient dire (« lyrique », adjectif dont on m’a parfois affublé, «
moraliste »…) « Romantique », je comprends peut-être un peu mieux, et
je m’en satisfais mieux, parce que cela recouvre des significations
qui, de Hugo à Delacroix, sont un peu révolutionnaires, même si on les
a oubliées. En tout cas, je ne recherche rien de dicible,
d’objectivable dans le voyage, sinon cet éloignement que j’ai dit, et
qui en lui-même n’est rien. Pas l’exotisme, pas « l’aventure »… Voyager
n’est sans doute pour moi pas autre chose que la manifestation, le
symptôme d’une « inappartenance » fondamentale. Michaux était, selon
son biographe Jean-Pierre Martin, « l’homme aux mille hôtels » ; je
n’en ai pas fréquenté autant, mais enfin j’augmente régulièrement une
collection de photos de chambres d’hôtel qui commence (pour l’instant),
par ordre alphabétique, à Achgabat, capitale du Turkménistan et se
termine à Wuhan en Chine (il faudrait que je me dépêche d’aller à
Zanzibar). Et cette collection fait elle-même suite à une autre, de
descriptions écrites, dont j’ai tiré la matière de Suite à l’hôtel
Crystal. (Je feuillette la biographie de Michaux et j’y trouve
cette
phrase de lui que j’aime assez : « Ah si je pouvais vivre en télésiège,
toujours avançant, toujours en de nouveaux pays, progressant sur des
espaces de grand silence… »)
Je me rends bien compte que je n’ai pas vraiment répondu à votre
question, mais ce n’est pas mauvaise volonté, c’est que je ne sais pas
y répondre. Je dois bien chercher quelque chose que j’ai perdu, dont
j’ai perdu même le nom… ceux que je retrouve, je sens bien que « ce
n’est pas ça ». Alors voilà : je ne sais pas précisément pourquoi je
voyage, mais je crois aussi que ce qu’il y a d’intéressant dans les
vies, c’est ce qui est gouverné par des puissances qu’on ignore.
GC – Vous avez
intitulé les deux volumes de votre œuvre complète : Circus.
Vous
écrivez dans Bakou, derniers jours : « Le cercle est ma
figure, la
matrice de mon intime géométrie. Ce qui revient, l’éternel retour ».
Cette figure se retrouve dans presque tous vos romans, sous des formes
plus ou moins sophistiquées (la spirale, par exemple). Une autre figure
récurrente est celle du labyrinthe (par exemple dans Suite à
l’Hôtel
Crystal). Comment analysez-vous ce double schéma ? Le rêve d’une
sorte
de perfection opposée au foisonnement et à la complexité du monde ?
OR – Vous êtes un bon lecteur, un lecteur qui
réfléchit, ce qui veut dire que vous formez des hypothèses qui sont
tout à fait plausibles mais qui donnent d’une œuvre des interprétations
que l’auteur n’a pas, ou pas complètement, pas consciemment, voulu
suggérer. Ce n’est pas une critique, au contraire : vous faites ce
travail d’élucidation qui tend à tomber en déshérence. Donc, votre
hypothèse me séduit, je l’adopte, mais je mentirais en disant qu’elle
met à jour un dessein tout à fait conscient de ma part. Elle est trop
parfaite, et cependant, si je l’adopte, c’est que cela y était en effet.
Alors je commencerais par dire, modestement : il y a de la manie chez
un écrivain. (Barthes : « Il y a dans le désir d’écrire un aspect
maniaque »). Tourner en rond en est un symptôme (je plaisante à peine).
Il faut tenir compte de ça. Plus techniquement, il m’a semblé, pour
certains livres un peu … baroques, qu’il fallait que quelque chose
fasse tenir ensemble la profusion des récits qui sinon risquaient de se
disperser. Il fallait enclore, englober. C’était le périphérique
encerclant Paris (Tigre en papier),
c’était la rotation et la
gravitation de la planète, reproduite tant bien que mal dans l’espace
feuilleté d’un livre (L’Invention du
monde). Vous avez donc raison
(mais je ne l’aurais pas dit d’emblée comme ça) : il y a d’un côté le
foisonnement, l’expansion du monde et des mots pour le dire, et de
l’autre la nécessité d’une forme, puisque nous sommes des êtres finis
(écrivains ou lecteurs). Écrire, on peut dire (mais je me méfie des
définitions) que c’est essayer de donner une forme à ce qui s’y dérobe
sans cesse, et quelle forme plus parfaite, en effet, partout égale,
sans accident, que le cercle ? C’est aussi l’image du retour, et que
cherchons-nous en écrivant sinon « le temps retrouvé » ? Écrire, ça
implique de trouver du même – non pas s’en tenir au même, bien sûr,
mais entendre les échos qui font le bruit du monde, voir les reflets
qui composent son image. Proust parle, dans Le Temps retrouvé, je
crois, des « anneaux de la métaphore ». Joyce révolutionne le roman en
faisant un tour par Homère, en trouvant de l’Odyssée dans la journée de
Léopold Bloom. (Je ne sais pas si je suis très clair…)
Je suppose enfin (mais peut-être aurais-je dû commencer par là – foin
de toute modestie –) que l’ambiguïté du mot « révolution »,
l’oscillation entre le sens astronomique et le sens politique moderne,
qui semble en être le contraire (mouvement circulaire, éternel retour
dans un cas, mouvement linéaire sans retour dans l’autre – Jean-Claude
Milner fait dans son dernier livre la savante exégèse de ce glissement
de sens) n’a pas peu contribué non plus à faire de moi un « cyclomane
»… C’est en tout cas incontestable, et conscient, s’agissant de la
structure « encerclée » de Tigre en
papier.
GC – Dans vos
romans, le récit est toujours pris en charge par un narrateur qui vous
ressemble étrangement, qui intervient dans le récit, le commente, fait
des digressions historiques, littéraires ou personnelles. La fiction y
est pourtant très présente, même dans un livre apparemment aussi
autobiographique que Tigre en papier : on est très loin de ce
qu’on
nomme « l’autofiction ». Cette dialectique de la fiction et de
l’authenticité est-elle essentielle à vos yeux ?
OR – Je ne sais pas si elle l’est en général – bien
des auteurs prétendent s’affranchir de l’un ou l’autre terme – mais
pour moi elle l’est en effet. Je ne me sens nullement enclin à «
l’autofiction », terme dont je n’ai jamais bien compris la charge de
nouveauté qu’on lui prêtait (je crois – j’ai aussi écrit à ce sujet,
dans Bric et broc – que ce
qu’on nomme ainsi est une mode littéraire
correspondant assez strictement à ce qu’un ami à moi, l’historien
François Hartog, a nommé le « présentisme »), qui comporte aussi des
expressions publicitaires – « Osez être vous-même » – etc. Je ne me
vois pas non plus (hélas !) écrire Vingt
mille lieues sous les mers. Je
travaille, comme beaucoup j’imagine, avec des souvenirs, des choses
vues, entendues, des choses lues, des rêves, et ce que l’oubli et la
fabulation tressent avec tout ça.
GC – Vous êtes
helléniste (votre note faramineuse en Grec à l’examen d’entrée à
Normale Sup est restée célèbre). Peu de vos livres où il n’y ait au
moins une allusion à l’Iliade ou à l’Antiquité. Au-delà du
plaisir de
faire passer, même brièvement, le souffle de l’épopée, faut-il y voir
le souci de maintenir le lien avec les cultures qui nous ont formés – à
une époque où, précisément, nos sociétés font table rase du passé ?
OR – Certainement. Mon attachement au latin et au
grec
n’a rien, ou peu de choses, à voir avec une nostalgie de ma jeunesse,
rien non plus avec ce que la sottise contemporaine a tôt fait de taxer
de conservatisme. Rien de plus vulgaire d’ailleurs, je le dis en
passant, que cette détestation actuelle de la nostalgie : n’a-t-on pas
le droit de rien regretter de ce qui fut ? De préférer les Halles de
Baltard à celles d’aujourd’hui ? L’époque où les maisons d’édition
étaient indépendantes, et non des biens sur le marché ? Où l’éloquence,
et non la démagogie sondagière, était une des parties de la politique ?
Où l’idéal de la culture populaire était représenté par le TNP plutôt
que par TF1 ? La haine du passé est une étrange maladie. C’est une
lâcheté et un conformisme lamentables que de croire, ou de feindre de
croire, que l’avenir ne doit pas se construire pas avec une part de
passé. Un écrivain, en tout cas, ne peut pas penser ça. Au début de
tout, pour un écrivain, il y a l’amour de la langue, l’idée
flaubertienne que « la prose française peut arriver à une beauté dont
on n’a pas l’idée ». Et aimer la langue, c’est la connaître dans toute
son extension, tous ses strates et registres, « nobles » et « vulgaires
», mais aussi dans son histoire. Le français n’est pas né de la
dernière pluie. Le latin et le grec, pas seulement ces langues, mais
surtout elles, l’ensemencent, la façonnent. Et elles ne sont pas
seulement la matrice de ses mots et de ses formes, elles sont aussi à
l’origine de beaucoup de ses façons d’objectiver le monde. Le jour où
on aura oublié d’où viennent les mots « démocratie », « théâtre », «
philosophie », « poésie », il est à craindre qu’on aura oublié aussi le
sens de ces mots. L’abandon (quoi qu’on en dise) de l’enseignement des
langues mères n’est qu’un des épisodes de la démolition générale de la
langue qu’on observe partout si l’on veut bien garder les yeux ouverts
– dans la rue, sur les enseignes des magasins, des cinémas, à l’école,
dans les journaux. C’est exactement ce qu’on appelle une sape : on
creuse par en-dessous, afin que l’édifice s’effondre plus sûrement. Je
ne suis pas tout à fait aussi extrémiste qu’Alain Borer dans son livre
De quel amour blessée, mais je
partage tout de même l’essentiel de ses
thèses – et de ses colères. Les imbéciles appellent ça du nationalisme
linguistique. Ayant toujours faufilé dans mes livres des vocables voire
des phrases entières de langues étrangères, je ne me sens pas très
concerné par l’imputation. Je ne prétends pas qu’il soit obligatoire
d’écrire « clef », à l’ancienne, mais quant à moi si je continue à le
faire c’est parce que j’y lis en filigrane la clavis latine, que ce
faisant je comprends aussi le nom d’un os qu’il est désagréable de se
casser, d’un ancêtre du piano, que ce petit « f » muet accroche à mon
trousseau la llave espagnole,
la chave portugaise, la chiave italienne,
et que c’est ainsi (entre autres) que je suis européen. Un vieil
Européen, certainement…
GC – Aucun de vos
livres, même ceux qui se présentent comme des romans, ne déroule un
récit linéaire. Vous avez même fait l’éloge – et c’est mieux qu’une
boutade – des « romans "mal construits" ». La fragmentation du récit,
les courts-circuits temporels, la bride laissée au hasard, la
multiplication des sens, les digressions, etc. sont typiques de la
modernité. Comment l’analysez-vous ?
OR – Je ne vais pas revenir sur des choses qui sont
archi-connues. La « modernité » – qui remonte quand même à un peu plus
d’un siècle ! – peut dans bien des domaines, en littérature, en
peinture, en musique etc. – être sommairement décrite comme une
déconstruction. (Et quand je dis « un peu plus d’un siècle », c’est
trop rapide, car en toute rigueur il faudrait remonter, s’agissant de
la littérature, au romantisme allemand, à Novalis, etc.) Je me
contenterai de renvoyer à ce que dit Claude Simon dans son Discours de
Stockholm : le roman moderne n’est pas un apologue, une histoire
allant
d’un début à une fin pour délivrer un enseignement ; il est une
aventure de la langue, passant, bifurquant par les mille « nœuds »
qu’elle propose, jusqu’à revenir souvent à ce qu’il appelle « la base
de départ » : la figure du cercle, encore…
GC – Il y a
fréquemment chez vous, au moment d’énoncer une idée ou un sentiment
personnels, une hésitation, une réticence, ce que Pierre Schoentjes a
défini comme « une attitude d’adhésion et de distanciation simultanées
», qui donne à vos livres un ton très particulier. Le souvenir des
errements de la jeunesse ?
OR – Eh bien, je l’ai déjà dit : je ne suis pas un
adhérent. Même à moi-même. L’affirmation n’est pas mon fort. Ou plutôt,
elle est un démon toujours présent, que je m’efforce de contenir dans
mon activité d’écrivain (dans la vie courante, je crains que ce ne soit
autre chose). Cela a à voir avec « les errements de ma jeunesse », en
effet – ou tout au moins (vous voyez que ma réponse ne déroge pas à la
règle que vous venez d’énoncer) c’est le roman que je m’en fais. De
toute façon, les idées, et même les sentiments, méritent d’être
examinés sous toutes les coutures, non ? Et souvent on s’aperçoit qu’il
y a des coutures qui lâchent. Je ne sais pas comment vous le dire sans
me répéter trop : j’ai toujours en moi un être catégorique, impérieux
jusqu’à la violence ; et c’est celui-là que je tiens en lisière, depuis
bien longtemps maintenant, grâce à la littérature – celle que je lis,
celle que je fais. Je préfère cette personnalité littéraire, plus
apaisée (enfin, « apaisée » n’est pas un mot qui me convient ; à vrai
dire je ne me souviens pas d’avoir jamais été en paix ; alors, disons :
sceptique, ironique). J’espère que des circonstances désastreuses, qui
ne sont plus tout à fait imprévisibles, ne feront pas resurgir mes
démons intimes.
GC – L’un des
traits
les plus constants de votre écriture est l’ironie. Elle prend des
formes très diverses, du jeu avec les codes du roman (la structure en
poupées russes de Suite à l’Hôtel Crystal) et avec les niveaux
de
langue, jusqu’au burlesque (la drôlatique soirée chez Nina d’Un
Chasseur de lions ), en passant par l’autodérision (Bakou
derniers
jours), la parodie (ces pages de L’Invention du monde où les
héros de
la guerre de Troie sont changés en deux chauffeurs avinés qui se
poursuivent autour d’un car) – sans parler des nombreuses références à
Tintin… Si elle n’est pas qu’un moyen littéraire, que manifeste-t-elle
? Un détachement par rapport au récit, un désenchantement ?
OR – Votre question est diverse et appelle diverses
réponses. Désenchantement, non. Quand j’écris un livre, il n’y a rien
de plus sérieux pour moi. Naturellement. (Je dis ça, « naturellement »,
mais il y a des auteurs dont on a du mal à croire qu’ils prennent au
sérieux leur travail.) Mais en même temps, je déteste les gens, et
spécialement les écrivains, qui « se prennent au sérieux ». Dans un
temps d’exhibitionnisme exacerbé, d’ « autofiction » et autres parades,
on m’a parfois reproché, curieusement, de me mettre en scène dans mes
récits (dans Un chasseur de lions, notamment). Mais l’idée ne me
viendrait pas de me faire figurer autrement que sous les traits d’un
personnage légèrement ridicule, ou en tout cas déplacé. Il y a toute
une idéologie de l’écrivain comme prêtre d’une religion profane (de la
religion de soi, éventuellement) qui me dégoûte. La lecture, à
l’instant, d’un article consacré à Gombrowicz dans En attendant Nadeau
(que ce soit l’occasion de les saluer au passage), me fait me
ressouvenir d’une phrase de son Journal,
je crois, qui m’avait intrigué
et impressionné lorsque je l’avais lue pour la première fois : « Tout
art en général frôle le ridicule, la défaite, l’humiliation ». Nous
avançons en tâtonnant, le doute est notre compagnon, nous voudrions
soulever le monde et finalement nous n’avons fait qu’ « une chose de
plus ajoutée au monde », comme le dit le conte de Borges intitulé « Une
rose jaune ». Cette ironie, je ne l’ai pas reçue tout de suite, mes
premiers livres en sont assez dépourvus ; il arrive qu’on s’améliore en
vieillissant…
La parodie, par exemple celle que vous évoquez dans L’Invention du
monde, c’est autre chose, c’est un hommage, une
référence-révérence
facétieuse. Il y a pas mal d’autres saluts de ce genre dans
L’Invention…, adressés à La Vie mode d’emploi (les ch. 31
et 32), à
Ulysse (début du ch. 37), etc.
Quant au « jeu avec les codes », cela répond à la conviction que ça ne
sert à rien d’écrire si on ne tente pas de temps en temps quelque chose
de neuf. On n’en a pas toujours l’audace, tous les sujets ne s’y
prêtent pas, mais je continue à faire mienne la phrase de Calvino (un
auteur qu’on lit moins, me semble-t-il, comme Borges aussi : on a tort)
que j’avais citée dans le post-scriptum
de L’Invention… : « Il faut
que
poètes et écrivains se lancent dans des entreprises que nul autre ne
saurait imaginer si l’on veut que la littérature continue de remplir
une fonction. » Et puis, il n’est pas mauvais de jouer un peu, ça
rappelle qu’écrire n’est ni un sacerdoce ni une torture. Je vais sans
doute choquer les flaubertiens extrémistes, mais je trouve qu’il y a
quelque chose d’un peu lassant, d’un peu surjoué, dans les plaintes
récurrentes sur la douleur d’écrire dont sont pleines les lettres de «
l’ermite de Croisset ». (Je caricature peut-être un peu ; je sais bien
qu'il lui arrive aussi, parfois, de parler de la « douceur » qu'il y a
à « faire des phrases », de la « joie » que cela donne.)
GC – Votre langue
est d’une extrême diversité. Vous recourez à tous les niveaux de
vocabulaire, du plus savant (le latin et le grec) au plus familier et
même, à l’occasion, au trivial. Est-ce une façon de dire la totalité du
monde ? Il semble y avoir chez vous, et pas seulement dans la langue,
une sorte de volonté démiurgique…
OR – Oui, c’est cela, c’est un effort (vain, bien
sûr,
on le sait, mais ça n’empêche pas de le tenter) pour dire la totalité
du monde. J’ai hasardé quelque part, je ne sais plus où, la comparaison
de la langue avec une ville (je ne dois pas être le premier). Connaître
à fond une ville, c’est fréquenter ses beaux quartiers et ses
banlieues, ses palais et ses taudis, ses lieux de plaisir et ses
coupe-gorges, ses monuments et ses égouts, etc. Il faut relire
l’étonnant chapitre sur l’argot dans Les
Misérables. « Connaît-on bien
la montagne quand on ne connaît pas la caverne ? », demande Hugo dans
sa langue impayable… « Impayable », je dis ça parce que bien sûr
souvent sa virtuosité, son absolu sans-gêne font sourire, mais j’avoue
une admiration totale pour le génie verbal de Hugo. En français, comme
monstre de la langue, il n’y a que lui.
GC – Votre
écriture
fait preuve d’une grande mobilité, elle « se réinvente de livre en
livre », selon le sujet que vous traitez. Il vous est arrivé de le
regretter, et même de douter de posséder un style propre. Un style,
serait-ce la pétrification d’une forme ?
OR – Je cherche une plasticité de la langue. Elle
doit
s’adapter à son objet. J’ai coutume de dire que j’écris selon
différentes « longueurs d’onde ». Il me semble qu’on n’écrit pas de la
même façon selon qu’on veut raconter l’histoire picaresque d’une bande
de jeunes gauchistes dans la France des années soixante-dix (Tigre en
papier) ou la descente aux enfers d’un homme sous la Terreur
stalinienne (Le Météorologue).
J’ai tenté le grand écart – pour voir,
par défi, pour m’amuser, aussi : essayer de décrire l’objet le plus
vaste et complexe qui soit, la Terre entière (L’Invention du monde) et
de simples petites choses, ce que j’appelle des « chétivités » – une
huître, une asperge, une mouche, un galet, etc. (À y regarder de près).
D’un livre à l’autre, le style – c’est-à-dire pour moi l’adaptation de
la langue à son objet – n’est évidemment pas le même. Je crois que cela
déroute certains. Libre à chacun de tenir cela pour de l’agilité
linguistique ou pour du simple contorsionnisme.
Ce que je veux ajouter, c’est que ce « réglage » se fait (ou ne se fait
pas) dès l’entame du livre. Gracq (un auteur dont je n’aime plus du
tout les romans, mais qui dit sur l’écriture des choses qui
m’intéressent, dans En lisant, en
écrivant, notamment), Gracq donc dit
à peu près (si je me souviens bien) qu’une foule de décisions se
prennent sans qu’on s’en rende compte dès la première page d’un livre.
Et parmi celles-ci, la « longueur d’ondes » (ça c’est ma formulation)
selon laquelle on va « émettre ». Si on la trouve, le livre se fait et
a une chance d’exister un peu. Sinon, pas la peine de continuer (et
d’ailleurs souvent on laisse tomber).
GC – Vous avez
beaucoup écrit sur les écrivains . Si vous deviez décrire « les ruines
de [vos] lectures », selon votre expression, « quel relief, quelles
figures » dessineraient-elles ?
OR – Je partais d’une citation de Valéry qui dit :
«
La suite des temps transforme toute œuvre – et donc tout homme – en
fragments », et je me plaisais à imaginer une éripiologie, une «
science des ruines » (vous voyez que le grec me sert au moins à forger
des néologismes…) qui étudierait ce qui reste des livres dans nos
mémoires. Une ville bombardée… C’est difficile à décrire, c’est vaste,
enchevêtré, difforme… Juste quelques grands pans de mur, les premiers
que j’aperçoive, les plus immédiats, les plus évidents : les adieux
d’Hector à Andromaque, sa songerie sous le rempart de Troie, la
supplique de Priam… Le prince André à Austerlitz… Leopold Bloom faisant
frire ses rognons… « Frères humains qui après nous vivez… » (et la
reprise de cette prière qu’en fait Pierre Michon dans « Le ciel est un
très grand homme »)… Madame Arnoux venant voir Frédéric, longtemps
après, ses cheveux gris… (je relis le passage de L’Éducation
sentimentale : ils sont blancs, en fait)… « Au loin le
remorqueur a
sifflé… », la dernière page du Voyage…
« On exagère, on exagère ! » :
le duc de Guermantes partant pour la « redoute », contrarié par
l’annonce de la mort d’Amanien d’Osmond, toute la matinée chez la
princesse du Temps retrouvé…
« Dans un mois, dans un an… », « Ariane ma
sœur… », « Hé bien ! connais donc Phèdre et toute sa fureur », beaucoup
de vers de Racine, des pans entiers de Shakespeare… Le soleil cou
coupé, le soir de demi-brume à Londres… « Il fait tellement froid que
le vin gèle dans les bidons… », les soldats débarquant du train dans
Les Géorgiques, la neige, la
nuit, les chevaux, le tintement des
éperons et des fourreaux… Le consul ivre dans son jardin en friche de
Quauhnahuac, « Vous êtes no un l’escrivion, vous êtes l’escopion, et
nous fousillons les escopions au Méyique », la fin du Volcan… Allez, on
va s’en tenir là…. Les grandes ruines, les très visibles. (Vous m’avez
demandé « quelles figures » dessineraient ces ruines, et je vous ai
répondu à côté, par une énumération, parce que je ne suis pas sûr que
ce vrac dessine une figure, ou en tout cas il n’est pas dans mes cordes
de l’apercevoir : mais vous le ferez peut-être. Il y aurait une
certaine mélancolie là-dedans que ça ne m’étonnerait pas…)
GC – Les
références
aux poètes, explicites ou non, sont nombreuses dans votre œuvre, de
Phénomène futur, au titre mallarméen, jusqu’à À y regarder
de près,
d’inspiration pongienne. Quel rapport entretenez-vous avec la poésie
comme lecteur ? Vous inspire-t-elle comme écrivain ?
OR – Les prosateurs se sentent toujours un peu
timides
lorsqu’ils doivent parler de poésie, ou parler à un poète, ou pire
encore parler de poésie à un poète : là c’est le cauchemar… On a peur
d’être pris en flagrant délit de balourdise. Alors, pour éviter de
faire une réponse prétentieuse, ou vaine, ou insuffisante, je vais
encore biaiser : je crois avec Flaubert qu’ « une bonne phrase de prose
doit être comme un bon vers, inchangeable,
aussi rythmée, aussi sonore
», ou avec Mallarmé que « toutes les fois qu’il y a effort au style, il
y a versification. »
juin 2017