
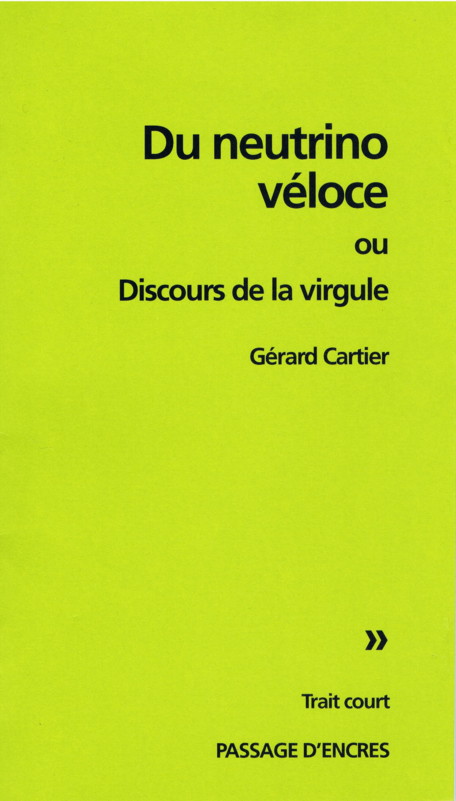 |
Du neutrino véloceou Discours de la virgule(Passage d'encres, 2015)Dessin de Marc Giai-Miniet |
 |
Cabinet de
société (Henry, 2011), un recueil d’une
soixantaine de récits écrits en hommage aux « saints Lagarde et Michard »,
qui évoquent de façon souvent lointaine et
déguisée les écrivains notre adolescence (et
quelques autres), se termine par la notule suivante :
À l’occasion de la composition du présent volume, une furieuse controverse s’est élevée entre l’auteur et l’éditeur sur l’évolution de la langue et l’usage de la ponctuation, suite à quoi l’auteur a écrit un dernier récit, Du neutrino véloce ou Discours de la virgule, qu’on peut se procurer chez l’éditeur, accompagné du point de vue de ce dernier, Des petits pois aux lardons cum commento.
Le présent récit est donc le fruit de cette furieuse (et
amicale) controverse. Il a pour sociétaire secret Olivier Rolin. Quant aux petits pois aux lardons du rusé
Jean Le Boël, ils n’existent pas plus que les Poys au lard de
Rabelais qui, dans sa préface à Gargantua, les fit
malicieusement figurer dans la liste de ses ouvrages.
La version initiale a été publée dans la revue Secousse n°13 (juin 2014).
