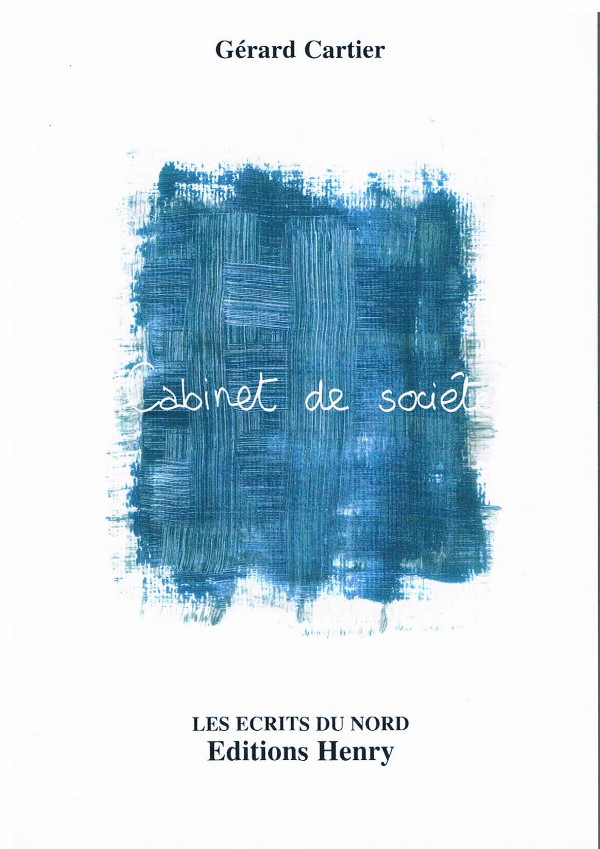Chemins d'Auvergne
(Turold)
Pas un souffle. Rien ne bouge, sinon les mouches, et des myriades de
sauterelles saccageant les prés. L’été pèse
comme une armure. Les ruisseaux sont si maigres qu’on se croirait en
Campanie. Parfois, entre deux rochers, la croupe du Méjean
où flottent mollement les étendards d’Ancelin. Si ce
n’est lui et les siens, le pays semble abandonné. Une femme
parfois sous un talus, ou un chien égorgé. Mais que
m’importe de me risquer ? Rien ne me fera dévier de ce chemin
qui descend vers l’Espagne. On dit que là-bas la montagne est
haute et sauvage, les loups y prennent ceux qui vont seuls, les Basques
brûlent leurs maisons à notre approche et ne nous laissent
que la pluie et la faim, et l’infidèle est en bas qui attend
dans les bois. À peine si tout cela me touche. Je pense à
Séléné. Mon cœur est gros de cette passion trop
longtemps refusée. Elle que j’ai chantée follement,
cachée de tous sous ce nom chimérique, elle était
lune en effet et a passé comme elle. C’était de ces
femmes mêlées qui vous enivrent et ne vous laissent qu’une
éternelle nostalgie.
Sous le causse, à l’orée de la forêt, une croix de
troncs écorcés signe le lieu où Ancelin s’est
arrêté. Il y a là un millier de bricons
vautrés sous les arbres et cent gros chevaux qui broutent les
luzernes. Le roman, je le leur donnerai d’un trait, deux heures durant
sans débander, tant qu’à la fin leurs gourdes seront
vides et qu’ils s’endormiront demi-nus dans les herbes. Ils veulent du
sang et de l’or : je leur couperai des nez et leur fendrai des armures,
le cheval avec le cavalier, puis je leur jetterai aux pieds les
trésors de Saragosse. Ils veulent rêver : je leur donnerai
les sept Espagne et je les multiplierai. Ils s’abattront au milieu des
harems, ils sueront dans l’agonie, un nuage lumineux les
enlèvera au ciel – ils en resteront bouche bée, comme
s’ils entendaient le cinquième évangile. Si la
mémoire me fait défaut j’y mêlerai ma vie, le
soleil et les loups, car moi aussi je souffre sur les chemins, et
l’ombre de Séléné.
L’orage toute la nuit a renâclé sur l’Aubrac. Les chemins
sont couverts de boue, les chevaux peinent, les chariots se renversent
dans les fossés. J’ai laissé l’armée et pris par
les collines, à travers les forêts de châtaigniers.
Dans l’ombre des talus, de grandes digitales vacillent sous la queue du
cheval qu’agace une nuée des mouches. De loin en loin de petites
églises penchent dans les orties. Cela vaut bien les
cathédrales d’Allemagne et les citronneraies de Naples. J’ai
beaucoup vu, je me suis émerveillé : aujourd’hui, un
verger de poires, clair et ordonné, un ruisseau bordé de
saules, une petite Vierge dans une niche à l’angle des chemins,
cela me comble mieux qu’autrefois les duchés d’Italie. Je ne
suis plus fait pour le bonheur. Complaisance ou vérité,
je ne peux oublier mon amie. J’ai fait de moi une châsse, elle y
est ensevelie, je la revois sous son bandeau, les yeux fermés,
embaumée dans son éclat. Le chemin tourne longtemps dans
les collines. Enfin, dressé sur son éperon, voici le
château du vice-roi des Bourines : dix pierres sèches
couvertes d’un drapeau, et un grand ciel pommelé qui passe sans
se poser.
Le froid est venu d’un coup, dans la grande salle le feu tousse, le
vent qui descend par le trou me chasse la fumée au visage. Ils
sont là à boire et à se lutiner, tandis que je
m’évertue avec des héros morts depuis belle lurette. Ces
géants dont l’épée fendait les rochers,
étaient-ils autres que ceux-ci ? Je pousse péniblement
mon roman, frappant du pied sur les dalles pour faire écho aux
vers : ahan… sang… dolent...
Ils dodelinent sur l’épaule de leur voisine et leur main glisse
insensiblement sous la nappe. Je m’en vais vous les rappeler, moi : Aoi !
Le double clerc qui sommeillait reprend vitement sa plume et s’absorbe
dans sa tâche. Sa main court après moi sans me rejoindre.
Je multiplie les embûches pour le semer, il lève les yeux,
se renfrogne, puis sourit lui aussi, et nous sommes comme deux lutteurs
qui s’étreignent sans vouloir la victoire.
Il me fera donner un repas de gras et deux pièces d’argent de
Poitiers. Peut-être, si le vice-roi se souvient de mon nom,
passera-t-il aux châteaux voisins, et je trouverai ici, quelques
semaines, une sorte de rémission. La servante aux traits maures
sur quoi mes yeux prenaient appui pour louer
Séléné sous un autre nom, contre un demi-denier me
rejoindra peut-être ; ou bien, sans me tenir rigueur de mes
rodomontades, elle qui a oublié l’Alcoran, et toute sa
parentèle, viendra-t-elle d’elle-même, enivrée par
l’aventure, se frotter au prestige de ma bouche. C’est que le cœur,
même aux servantes, est trop vaste pour se satisfaire des
Bourines et de l’Auvergne, et qu’il veut approcher cet au-delà
qui affleure parfois dans les vers. Cette nuit, je rêverai de
nouveau de Séléné, comme au temps de ma force, et
j’embrasserai ma gloire.
Dix années ont passées, ma tempe est blanche. Nous
campons depuis des mois au pied des murs d’Antioche. Les chevaux
hennissent, les épées tintent, la poussière fume :
tout est vrai. L’ennemi a peu de visage, et moins de droiture encore.
Femmes plutôt qu’hommes. Ils vous percent d’une flèche
dans le dos et s’enfuient sans combattre, ou vous décollent la
nuque de leur sabre sans sortir du buisson où ils se sont
cachés. Leurs émirs sont faux comme des valets, ils tuent
au poison et tiennent des serpents dans des couffins pour les
ambassadeurs. Il est juste qu’un quartier de lune leur serve de
drapeau. Quant à leur langue, quel effort il nous faut faire
pour y répondre sans sortir de l’humanité… Certes, nous
n’aurions pas pensé que ce pays fût si rude, ni ses hommes
si vils.
Nous resterons ici tant que Jérusalem ne sera pas reprise. Leurs
temples seront rasés, il n’en restera que le plan dans les
collines, et le nom dans les récits de nos successeurs, qui en
réjouiront les potentats d’Auvergne et s’en réjouiront
dans leurs servantes. Nous, nous resterons ici pour toujours, nous en
ferons un paradis. Oranges et citrons, fenouils, bois de cèdres,
rien qui n’y soit à notre goût. Je me retirerai dans la
montagne, au-dessus d’Antioche, une maison arabe barbouillée au
lait de chaux, trois fois rien, une porte basse et une salle au sol
battu. Un verger, quelques biques, un jardin sec qui fournira pour
l’œil et pour le nez. J’y oublierai tout, le causse boueux et les
tumultes de la guerre. Je pourrai enfin me livrer à
Séléné. Elle me sera tout jusqu’à la mort,
mieux qu’autrefois peut-être, non la lune variable mais un soleil
constant.
Haut de page