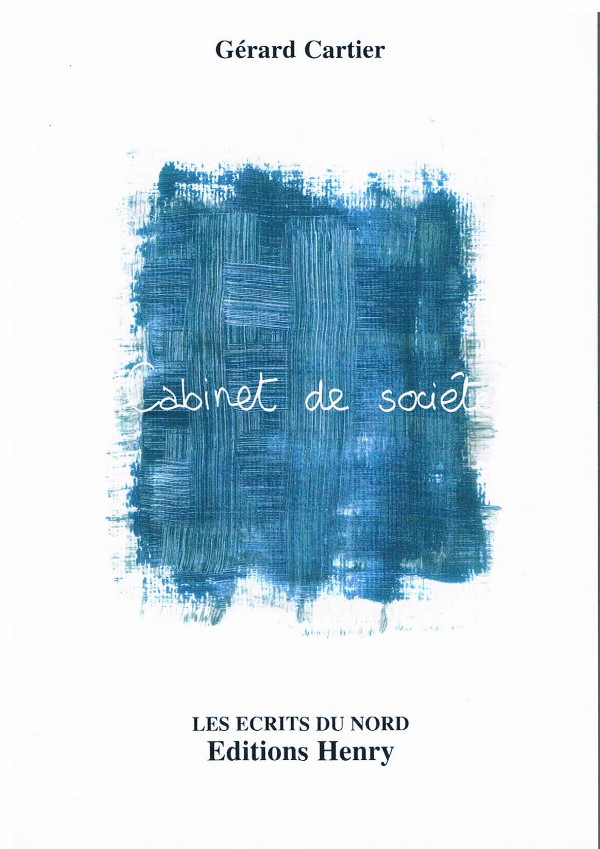Discours des Charmettes
(Jean-Jacques Rousseau)
Moi
aussi je parlerai de moi. Ayant cédé à une manie
ambulante, j’ai sans y prendre garde mis mes pas dans les siens.
Avant-hier parmi les Piémontais, claquemuré au-dessus des
arcades qui mènent au château du roi sarde, j’ai appris
à mes dépens les usages du lieu et de chaque soubresaut
du hasard me suis fait un roman. Hier, ayant passé les monts,
j’ai atteint Chambéri. Nous voici donc voisins. Lui au fond
d’une fausse rue, dans ce grave bâtiment où l’air ne
parvient pas, dont les planches pourries cachent blattes et rats : l’un
d’eux s’est couché une nuit sur le sein de sa maîtresse ;
moi au flanc de la colline, au-dessus des toits tortueux, toute la mappe de la ville à mes pieds.
C’est un dédale de passages, de boyaux rances,
d’arrière-cours fermées aux vivants. Parfois, du
côté de Croix d’or ou de la rue des Nonnes, une grille
grince sous un porche et soudain vous le livre : il traverse une
courette, les Cantates de
Clérambault sous le bras, et gravit d’un pas pressé les
escaliers de pierre pour courtiser en italien une jeune fille
grêle aux yeux brillants ou une froide effigie promise à
quelque épicier. La mère peut-être l’agace en
secret et le baise sur la bouche, de l’aventure il ne tire que son vin
et son lard. À midi, regagnant son cachot, c’est à peine
s’il voit, dans le puits des toits, flotter un peu de ciel.
Les saisons pèsent, enfermées dans les murs, et
bientôt il étouffe, un mal aigre le tourmente, oppressant
le corps et épuisant l’esprit. Un jour, abîmé dans
sa pensée, ayant par mégarde franchi les murs d’enceinte,
il fait deux pas dans la colline : là, entre un verger et des
terres vignes... Me hissant sur mon pigeonnier, face aux Bauges, et
penchant la tête sur l’épaule, j’entrevois dans l’est,
dans une trouée entre les toits, la courbe sauvage du vallon des
Charmettes.
Une route sombre le mène en peu de pas, que l’on suit à
son tour un dimanche, dans l’extase de l’été, quand
l’orage gronde au loin sur la Chartreuse et qu’on se souvient de son
enfance. Une mince rigole vous fait tout le long la conversation,
acacias et châtaigniers se mêlent d’un versant à
l’autre, des fleurs mauves pointent sous les buissons. À
mi-chemin, une grive babille dans les herbes, ou un rossignol
perché sur un poteau télégraphique, et ce chant
déchirant vous arrête. Le vallon se resserre, on le gravit
lentement pour ne rien perdre de son sentiment, retardant un but dont
nous suffisent les prémices.
Bientôt, un chemin tournant pavé de galets grimpe entre
deux haies de buis. C’est là, au penchant de la colline, sur une
étroite terrasse, une maison aux contrevents gris fleurie de
glycine, belle et sévère comme les pensions des
récits d’initiation. L’ombre y est presque fraîche. Portes
grises, murs de salpêtre gris et roses, plafond gris. Je m’avise
de détails d’huissier et les note, comme Lélia, pour m’en
servir à mon livre : deux chaises, un vaisselier... au-dessus des portes ornements chinois...
Une cheminée obturée. Une épinette aux phalanges
brisées. Au mur un miroir de plomb où passe un spectre,
dont le talon sonne sur les carreaux. Et tout à coup, par la
fenêtre, je découvre le jardin.
À l’étage, petit autel de bois
peint offert à Notre Dame des ermites : elle n’a qu’un lit court
et une bibliothèque où un pot de cinabre cale une
Pratique de Médecine. L’ermite a plus loin son lit, dans le
renfoncement d’un réduit, et moins de biens encore : un
crucifix. Entre eux le plancher craque et ondule, un chat passe de
l’une à l’autre, et des désirs tempérés. Vous resterez bien loin. Ne passez pas la porte. Venez maintenant, mon petit...
L’ombre trottine sur les planches, le silence. Rien qui ne soit pauvre
et ingrat. Mais se penchant à la fenêtre tout le jardin
s’offre. De cela, ils ont fait leur paradis.
Au pied de trois marches, sous des murs bas, est enfermé un
closeau d’herbes aux allées rectilignes, aux casiers rigoureux,
ordonné comme une pharmacopée : ici la sauge et la
livèche, là l’hellébore, la valériane. Le
vent du soir fait osciller les tiges sans froisser les pages du fragile
herbier. On peut rester là sans bouger, l’esprit
perméable, écoutant les abeilles industrieuses, respirant
le musc qui tombe de la montagne. Sans doute je me répète
– je le ferais bien plus si je disais à chaque instant ce qui me
tourne dans la tête.
Pour qui sait la regarder la nature est peu rusée. Les sucs
bienfaisants, les laits vénéneux s’exhibent à
l’œil, chaque plante érige sa vertu en feuilles, en épis,
en gousses, de leur mélange naît une étrange
harmonie, telle que ne sait pas l’engendrer la société.
Qui n’a appris de ses maîtres que l’arithmétique et la
géométrie veut déchiffrer dans toute chose un
ordre : et il reste à rêver devant ce cabinet d’essences
dont chacune le jette dans un sentiment pur. Les hommes sont tout
autres : tant de sentiments cachés sous si peu de visage…
Que les hommes soient feints,
c’est ce qu’en disent les livres : les tablettes de buis des anciens,
qui ne savaient rien des sciences systématiques et tiraient tout
de l’expérience, et les traités des modernes, qui
dérivent leur science d’un excès de système. Ils
disent L’HOMME ! et vous
extraient de sa vésicule un litre de bile qu’ils vous jettent
pour preuve à la face. Moi qui la connais si peu, j’admire comme
ils savent composer l’humanité dans de vastes doctrines. Lui
surtout, qui peut-être s’y était frotté plus que
tous, arrachant à chacun de ses congénères son
vice ou sa vertu, les rangeant par espèces et par classes, et
composant de ses exsiccata une nomenclature où se
révèle le désordre de la société.
Au-dessous du jardin est un verger penché. Le pied glisse sur
l’herbe humide, la canne de fer s’enfonce dans la terre, et une femme
qui peut-être feint de tomber s’agrippe à votre bras. Elle
boitille un peu, à ses cheveux s’accrochent des graines
duveteuses dont on lui trace de mémoire, dans le latin de
Port-Royal, le vaste cousinage. Dans les branches vernies voltigent les
rousserolles : de cela aussi faire son étude, et des insectes
qui folâtrent sur la prairie. Les arbres portent leurs pommes
comme autrefois, d’anciens délices à peine
remémorés. Chercher en soi cette saison perdue, en
composer peu à peu sa phrase, tournant dans la bouche les mots
et crachant les pépins : Ici... ici le court bonheur de ma vie...
Je l’aime peut-être pour ne l’avoir pas lu. Je retarde depuis
trente ans l’instant d’ouvrir ses livres. Pourquoi me presserais-je ?
Il faut auparavant l’éprouver longuement. Le moment venu, ce
seront d’abord les Rêveries, et les Confessions ensuite, si je vis assez. Quant à l’Émile,
je n’en suis pas curieux : oui à la morale, mais non aux
règles. Il me semble avoir sacrifié autrefois au Discours sur l’inégalité.
Mais c’était un autre temps, la raison ambitionnait de s’emparer
de tout, je m’étais loué au vaste projet qui partageait
le monde, à quoi il avait par avance voué son talent
d’horloger : le déluge est passé là-dessus.
En attendant, mon Rousseau est celui des enfants. Il prend le chemin
des Charmettes et à mi-côte, sous les arbres de la haie,
une herbe violette le tire de sa rêverie. Au-dessous, un ru mal
dompté murmure sur les pierres. Je veux aimer et me donner au
monde, le bonheur est ce bouquet de pervenches, ce ciel léger
où une grive se plaint, car c’est le soir. Il est au pied de la
maison grise, les notes d’une épinette passent la fenêtre,
et une voix légère qui chante dans la langue du sud. Je
veux aimer et être aimé, que rien ne blesse le cœur, et si
l’on me dit Jean-Jacques, que ce soit très doucement.
in Cabinet de Société (Henry, 2011)
Version initiale in Europe n°930 (oct. 2006)
Haut de page