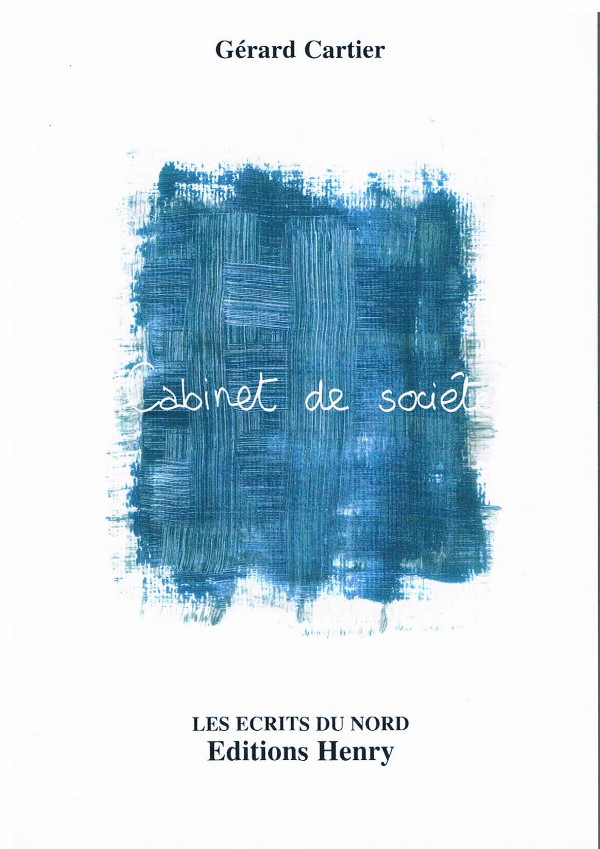Eaux et forêts
(La Fontaine)
Tous
ces grands seigneurs, qui n’aiment rien tant que l’ordre, rêvent
pourtant de la beauté. D’une forêt montueuse ils commandent qu’on fasse
un paysage : des tonnelles, des boulingrins, des terrasses étagées. La
vue s’étendra sans obstacle jusqu’à l’horizon, on doutera si c’est le
parc au loin qui se poursuit ou si c’est la nature. Et au milieu de
tout cela des folies, des statues extasiées, des étangs dans du marbre.
Dans les marais, les terrassiers s’affairent encore au grand canal que
l’eau gronde déjà dans le plomb des tuyaux. Et tandis que l’on étrenne
les allées, que les dames se risquent dans les rampes en balançant
leurs robes, dans des closeaux, au flanc de la colline, chèvres et
marteaux dressent précipitamment un faubourg de l’Arcadie. Tout y est
vu dans la distance des siècles et reproduit à proportion. Les dieux
seuls, qui sont ici-bas l’image du Roi et des siens, ont gardé leur
stature puissante ; le bras de Jupiter atteint le toit du portique et,
dans un temple de l’Amour suspendu à mi-ciel, Vénus dévoile un sein qui
fait honte aux géantes déchues.
Des escaliers çà et là donnent sur une charmille ou un courtil de pois.
Rien n’y trouble l’ombre et le silence, l’endroit est trop écarté pour
les courtisans et trop clair pour les amants. Seul, parfois, s’y perd
un promeneur fantasque qui fuit la foule. C’est une calme après-midi
d’été, il s’assied sur ses talons et tire de ses basques un feuillet.
Les abeilles qui pillaient les épis s’indignent de l’intrus et lui font
leurs semonces à l’oreille : il les met dans son sujet, une élégie ou
un conte italien. Les palmes d’Amérique oscillent avec lenteur, la mine
de plomb les accompagne dans l’ombre paresseusement. La brise pousse à
ses pieds un paquet de plumes, des oisillons s’essayent au vol, les
plumes hérissées, chassant les aigrettes des pissenlits. Bientôt une
cloche le tire de sa rêverie. Il revient par les quartiers et se joint
à un groupe. Puis la fantaisie le prend d’entrer dans le labyrinthe. Ce
n’est déjà qu’un dédale de ciel entre des charmes taillés. Il imagine
qu’on l’y a suivi, que ce sera la jeune femme dont il rencontre depuis
deux mois, à toute occasion, le regard pénétrant – il l’attend un
moment. Les autres continuent par les allées, moulinant les faits du
jour, les progrès du jardin et ceux de l’hérésie.
Si l’âme est à certains la seule occupation, il ne veut pas s’en mêler.
Le monde lui est un objet plus certain, il s’en tient à ses sens, la
tête morale sans doute, mais le corps libertin. Il aime tous les
plaisirs, la conversation comme la solitude, la musique et le vin, et
les mazarinettes qui entrouvrent parfois leurs triples robes pour
laisser s’y égarer sa main. Il y a à tout propos de longs dîners de
service, des gibiers et des fruits, des assauts de poésies légères et
des chansons jusqu’au matin, qui vous jettent enfin dans les brumes du
parc, au bras peut-être d’une marquise aux yeux brillants, ou de
quelque demoiselle plus complaisante de sa compagnie : pourquoi
résister à la beauté ? Ou ivre d’un désir mécontent, il se satisfait
d’un ami à qui ressasser un conte frivole en regardant deux ombres
passer hâtivement le seuil du labyrinthe.
Il se frotte aux gassendistes et se mêle de loin aux courtisans. Il
voit sous les lourdes perruques les crânes déformés par les passions,
sous les habits festonnés il sent les corps qui puent. Il s’amuse de
tous, de leur gloire et de leur vanité. La cour est un théâtre où
chacun exhibe un instant sa livrée colorée, ses attributs inscrits sur
la poitrine en grands caractères, comme dans les Sommes des péchés
des pères jésuites. On pourrait les réduire à si peu, un masque
échafaudé sur un costume brillant, sous quoi bouillent le sperme et le
vitriol. Ils déambulent en talons hauts sur les parquets, engoncés dans
leurs jupes, tournant des discours délicats qui écorchent l’oreille.
Ils flattent qui s’élève et exécutent qui chute. Ils poursuivent les
femmes dans leurs cabinets, les contraignent à force d’offrandes et de
menaces, et forniquent dans leurs soies à la volée. Ils mentent. Ils
dérobent. Ils assassinent. Lui, il regarde et ne dit rien. Un mot peut
vous conduire à Pignerol ou aux Petites-Maisons.
Bientôt il se rebute. Ce monde clos, ces terrasses où l’équerre et le
compas dessinent un simulacre d’éden, ce simulacre d’humanité qui y
poursuit dans les plaisirs ses terribles passions, tout à la fin le
lasse. Au-delà des murs, habilement dissimulée derrière des taillis,
c’est la campagne. Il s’assoit dans les feuilles et contemple les
champs mûrs, il regrette sa province. Le lendemain, il remballe son
bagage et tourne le dos. La voiture est trop lourde pour sa hâte :
passé Azy-sur-Marne, il laisse ses malles en arrière et pousse son
cheval. L’Arcadie est bien loin, ce ne sont que des pâtis, des étangs
sauvages, des collines modestes qui ondulent sous le ciel. Il y est
chez lui, il traverse au pas ce méchant triangle de nature dont il
connaît tous les secrets, il peut s’en croire le maître. Un ruisseau
dans la prairie, c’est son eau qui ondoie pour étancher ses bêtes ; une
forêt sur un coteau, des noisetiers, des bêtes rousses et l’incessant
bruissement de la mouche-asile, c’est son cabinet de verdure. Il entre
dans l’air sombre et desselle son cheval. Adossé à un fayard, à l’orée
de la futaie, le voici qui embrasse son domaine, non comme Fouquet ou
Gassendi, mais livré à la débauche de la contemplation.
Une vieille passe sur le chemin, une brassée d’herbes dans sa jupe.
Puis c’est un paysan qui rentre, un enfant court devant lui, un bâton
épineux à la main, dont il frotte l’échine de ses sujets, trois brebis
et un bouc aux cornes ondulées, puissant et vaniteux, comme on en voit
aux planches des alphabets. Ces êtres rustiques, tout vêtus de chanvre,
et si divers, comme les animaux des champs, ne font pas une comédie
plus vulgaire que dames et marquis. Il s’amuse de cela, des gens et des
bêtes : du vicaire qui rumine contre un tronc son bréviaire et des
vaches qui prient à genoux dans la boue ; de la jeune veuve sur son âne
qui le dévisage effrontément ; des chèvres dans les arbres qui scrutent
le ciel, sévères comme des astrologues. Et sous ces visages défaits ou
gracieux, sous ces faces pointues et ces cornes abondantes, il voit le
cœur humain qui parle ses cent langues.
in Cabinet de Société (Henry, 2011)
Repris dans Europe n° 1116 (avril 2022)
Haut de page