
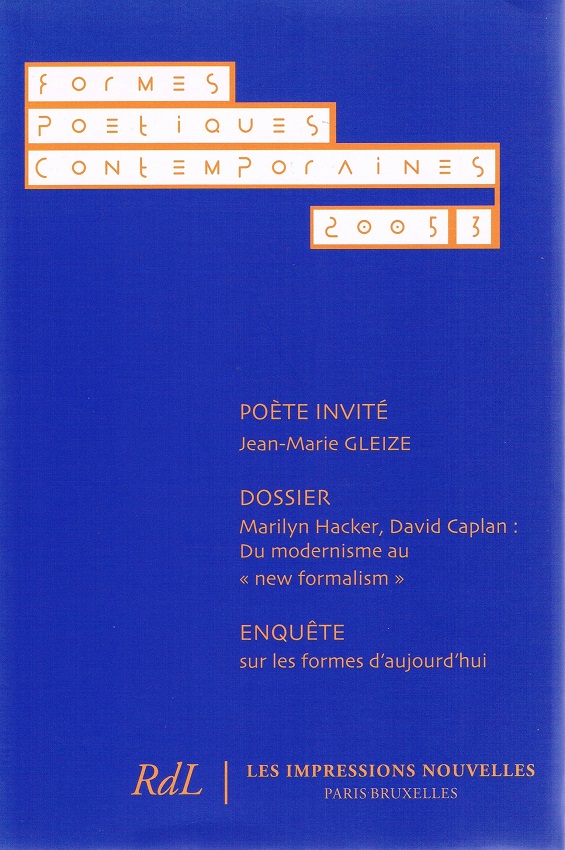
Le tarot du fou
C’est une tablette de cire, un rouleau de soie
compté par les mouches, un vergé quadrillé
à la règle. La main a longtemps hésité, un
mince bâtonnet suspendu sur la table, dans le silence à
peine troublé par le cri d’un colporteur ou par l’orage qui
secoue la montagne. Puis la pointe s’est posée : et tandis
qu’elle glisse précipitamment, que le pinceau se courbe, que le
bec de la plume fend la matière, une voix marmonne dans l’ombre
des volets. Ce n’est pas le jargon des affaires, ni la mémoire
des morts et des engendrements, mais une langue qui roule des galets,
un chant recto tono qui ne professe qu’un nombre. Prêtez l’oreille, écoutez : ils luttent avec les mathématiciens.
D’autres mesurent le méridien ou computent les étoiles.
Eux, c’est une folie bénigne, mais jamais leur démon ne
les laisse en repos. Et enfermés dans leurs cabinets sous un rai
de lumière, ils n’ont de cesse d’avoir dressé le cadastre
de leurs possessions. Et jusqu’aux choses les plus mobiles, leurs
inclinations et leurs terribles dieux, qu’ils veulent tenir dans leur
compas. Leur mesure est si courte pourtant, une simple règle
qu’ils manient sans repos. Là-bas, sur les falaises blanches,
c’est un stick marqué de onze encoches, dont ils frappent le sol
: A mighty mass of brick, and smoke, and shipping...
À l’est, sur la Vistule, treize disposées au hasard. Et
ici, au pays de la raison et de l’harmonie, douze bien
réglées, avec quoi mesurer les passions, les lois et les
saisons.
Puis tout change. Les petites lorgnettes qui parcouraient le ciel font
savoir ce que valait la vérité. Et eux, qui aigrissaient
dans leurs cubiculum, buvant l’absinthe ancestrale, mâchurant
leurs pages, eux aussi se prennent à douter. Ils poussent leur
porte – des villes se sont bâties, des machines fulgurent dans
les rues. Ils en sont saisis, ils s’enthousiasment et se ruent dans le
monde. La Sibérie se jette à la fenêtre de leur
wagon, le Titanic sombre sous
leurs pieds, ils meurent à Madrid et à Stalingrad. Ils
n’avaient pour maître qu’un principe sévère, ils
s’éprennent de la liberté. Photographier le
siècle, lacérer les affiches, noter sur de petits carnets
les faits-divers des journaux : l’étoffe humaine, qu’une autre
règle la mesure !
Laquelle, ils s’invectivent et en font des tempêtes. Ce sont des
dogmes, des querelles théologiques, des arguments à
charge et à décharge. Ils réécrivent le
droit canon, d’innombrables volumes, le canard aux lèvres de
vermouth et le mystère de l’unicité de la forme et de la
substance. Ils remettent en vigueur l’inquisition, adressent à
tous des vespéries, condamnent et brûlent. La
vérité est un jeu de nombres, une algèbre ; elle
est dans la main qui va sous la dictée des songes ; elle est
dans la gorge, elle est dans l’œil. À l’une le
bégaiement, à l’autre le mouvement pneumatique. L’un a
son boulier sur ses phalanges, l’autre fait son mètre de son
souffle, le troisième loue le hasard et défie les
fractals.
Avec qui s’accointer, à qui donner sa langue ? Ni à
ceux-ci, qui l’ont si longue qu’ils vont toute leur vie la bouche
gonflée, louant le haut et le bas – un dieu fantasque à
triple voix de femme ou les forçats du quotidien. Ni à
ceux-là, c’en est pitié, qui n’ont qu’un mince bout de
cuir desséché qu’ils mâchonnent longuement entre
leurs dents avant de le cracher au visage de leur siècle, car
ils savent qu’ils n’échapperont pas à la mort. Ni aux
sentencieux, ni aux mélancoliques, ni à aucun.
Turin a basculé dans l’hiver. De rares tramways oscillent dans
la nuit, des phares balaient par instants les façades : des
cours tracés à l’équerre et des portiques vides.
Une porte y rougeoie sous l’enseigne du fou du tarot : voilà
bien pour moi. Dans un coin de la salle, devant de petites bougies,
trois femmes font ensemble toute la beauté. Je les écoute
s’enchanter de rien, une langue légère qui court sans
fatigue. Puis, ayant touché le fond de mon noir Barbera et
repoussé les miettes, j’écris sans détourner les
yeux. Ce sera pour garnir mon Banquet : Attaché
à mon état devant
celle qui chante sans
voix sirène en
cheveux pas le
droit les yeux les
yeux à me déchirer... Trahissant qui j’étais, possédant un instant ce qui n’est pas.
Oui, je veux boire ce vin noir et tituber, et être à tous.
Puis me refuser, ne m’enivrer que de la nuit, endurer la solitude. User
de tout et dans rien ne m’enfermer. Que l’œil soit un jour le
maître, que le lendemain il soit aveugle. Que chaque instant
trouve sa forme. Si c’est un chaos, qu’il soit ordonné. Si c’est
une forme, qu’elle varie selon l’humeur. Et souvent me livrer aux
délices du doute. Que nul ne puisse dire : il est ce nombre –
car j’aurai dans mon égarement cette extravagance : me
mêler à la vie et être tous les chiffres.
Haut de page