
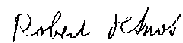 à Terezin |
La boîte de fer blanc(Europe n° 851 - mars 2000) |
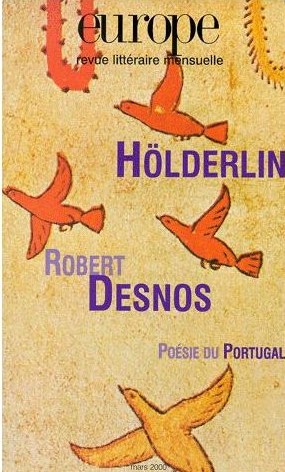 |
Nous allons vers l’Est.
Nous passons sans papiers la frontière. Au-delà, des villes
italiennes sous un ciel moutonnant, de vastes étangs
où dormir, des forêts abandonnées que
les trains traversent avec lenteur au milieu des bêtes. C’est l’été 75.
Rien
ne nous est refusé. Dans un hôtel de Bohème une noce sans
mariée nous y tient éveillés toute une
nuit, serrés dans un lit étroit. La vieille Fiat 128, bleue comme Lady
Roxelane Pervenche, erre sur les routes désertes
du socialisme réel. Au fronton fuligineux des églises, de grandes
banderoles rouges,
semées d’accents et de cédilles, exaltent ce qui fut et ce qui sera. Ce
qui sera, nous ne savons le
deviner. Ce qui fut n'est plus qu'une fumée.
En chemin vers Prague, à travers bois et campagnes, une route
à gauche menant vers une colline. Rien ne m'est resté que
cette image, travaillée par la mémoire, fausse
peut-être, d'un tertre sombre au milieu de la plaine. Nous
n'irons pas. Nous détournons les yeux. Est-ce Terezin ? Trop de
douleur, trop de cendres. Rien que cette montagne basse qui reste dans
l’œil, comme un moucheron que l’on ne parvient pas à ôter
du coin d'un mouchoir et qui
pourrit, aigrissant la vue. Terezin !
Au retour, je tiens
l’argument que je cherchais à l’aveugle
depuis des semaines, écrivant en aveugle sur des accordéons
de feuilles d’ordinateur. Le kommando de Flöha arrive à Theresienstadt.
C’est un paysage
solitaire où le soir descend et fait luire les feuillages. Dans
l'ombre,
des grappes d’églantiers réinventent les couleurs. Du convoi d’êtres
primitifs poussés comme des bêtes par les SS ne
restent que quelques fantômes, charriés dans des
remorques agricoles. Il est seul et nu, les lunettes brisées en route,
la boîte de fer où il gardait ses
poèmes perdue dans le voyage. Bientôt, il ne restera rien.
On publia à Prague, cet été-là, d'ultimes vers adressés à Youki :
J’ai
rêvé tellement fort de toi,
J’ai tellement marché, tellement parlé,
Tellement aimé ton ombre,
Qu’il ne me reste rien de toi,
Il me reste d’être l’ombre parmi les
ombres
D’être cent fois plus ombre que l’ombre
D’être l’ombre qui viendra et reviendra
dans ta vie ensoleillée.
Peu
après la libération du camp, dans les premiers jours de juin 1945, un
étudiant tchèque familier de la littérature surréaliste avait lu le nom
du poète sur la liste
des malades du Revier. Il avait reconnu, parmi les
mourants alignés dans le bloc, le visage du voyant de l’époque des
sommeils, dont il avait vu autrefois la photo dans Nadja...
« Connaissez-vous Robert Desnos, le poète
français… Oui ! Oui ! Robert Desnos, c’est
moi... » Comme ceux à qui il est accordé de
repasser le seuil interdit, Robert
retrouvait un instant la lumière et les mots. Il parle. La
liberté, les amis de jeunesse, l’amour, la Résistance.
Puis il ferme les yeux. « Parlez-moi...
Racontez-moi des histoires... » Il remue les lèvres
en silence. Le quatrième jour on l’emporte.
Le dernier poème,
qui semblait
dicté au-delà de la tombe, connut une fortune
exceptionnelle. « Une destinée singulière et
tragique a donné un sens concret au contenu du seul poème
trouvé sur lui ». Robert Desnos quittait
le monde par la porte des légendes.
On voulut le retenir dans les filets de la
réalité. On publia le récit de ses
derniers jours : « J’ai soigné
Robert Desnos dans les barraques du sud de Terezin à partir
du 4 juin, où je l’ai trouvé,
jusqu’à sa mort le 8 juin 45. À cette
époque je n’ai vu sur lui aucun poème,
et aucune pièce écrite, et d'ailleurs il n’était plus capable
d’écrire ». On crut
démontrer que le dernier poème
n’était qu’un malentendu. La traduction
française du poème publié à Prague à
l'été 45, poème déjà paru en
tchèque en 1931, qui n’était lui-même qu’une
traduction libre d’un
poème de 1926 inclus dans À la
Mystérieuse :
J’ai tant
rêvé de toi, tant marché,
parlé, couché avec ton fantôme
qu’il ne me reste plus peut-être, et pourtant,
qu’à être fantôme parmi les
fantômes et plus ombre cent fois que l’ombre qui se
promène et se promènera allègrement
sur le cadran solaire de ta vie.
On crut que les preuves suffiraient à tuer la
légende. En vain : on donne toujours, ici et là, le dernier poème
de Robert Desnos. Comment boucher l’oreille avide de merveilleux,
comment refuser le chant poignant qui monte d’au-delà de la
borne penchée ? Robert Desnos reste cette « ombre
parmi les ombres, cent fois plus ombre que
l’ombre... »
C’est dans cette lumière équivoque que je
commençai à écrire, sur de mauvaises feuilles
rayées, le poème qui deviendrait La
Nature à
Terezin.
Un paysage à moitié rêvé et à
moitié documenté, une figure fuyante poursuivie des
années, les traces de l'Histoire et celles de la légende.
Le poème fut longtemps pris et repris. Je cherchais le chemin
vers le bas. Des livres répandus au sol, l’œuvre de Poussin sur
les genoux, je mettais en application la leçon de Reynolds dans
son Discours sur la peinture
: « Ces
sortes d’histoires ne perdaient rien à conserver
quelque chose de l’ancienne manière de peindre
». Orphée, saint
Charles Borromée, les partisans vieillis
dans leurs grosses Tatras noires, Hippolyte sanglant, l’étoile rouge,
les lits de fer...
Mais quelle légende opposer à la
réalité ? Comment atteindre celui qui, chassé de
camp en camp, avait enfin atteint la nudité absolue ?
S'agissait-il de tout brûler, de rendre au silence les mots
impuissants, de faire soi-même le sacrifice du poème ? Au
bout de La Nature à Terezin, je traçai le plan
d’un livre plus naïf et plus humble, que je croyais ne jamais devoir
écrire :
1. Paris,
la nuit d'hiver (42-44).
2. Wir trinken dich nachts...
3. Le voyage
4. Le bûcher. une boîte de fer
noircie.
La Nature
devait buter sur l''insatisfaction et le silence. Rien n’avait
été sauvé.
Durant
les deux années de déportation, Robert Desnos avait
pourtant trouvé la force d'écrire. L'un de ses compagnons
d'infortune parle d’un long poème surréaliste
écrit
à Flöha, Le Cuirassier Nègre. « Il
nous en lisait des passages aussi obscurs que sonores. Le texte
était écrit sur des feuilles de papier à cigarette
enfermées dans une petite boîte en fer que
conservait le précieux Rödel, qui rimait lui-aussi
».
Au cours de leur longue marche forcée à travers les
Montagnes Noires, poussés par les SS qui fuyaient Flöha
devant la progression des armées russes, Rödel trop faible
pour suivre sera fusillé. Quand il arrive à Terezin,
malade, épuisé et affamé, Robert Desnos a perdu la
boîte de fer blanc qui le rattachait à ce qu’il avait
été. Une fin muette donne-t-elle une
leçon plus parfaite ?
Bien plus tard, je me suis mis en tête de tout reprendre et,
changeant de stratégie, d'écrire « cette nuit
primitive
»
dont le plan avait été dessiné à la fin de La Nature à Terezin. Il fallait
abandonner toute dévotion, repousser toute mélancolie,
dépouiller les vers de tout ornement. Embrasser la
matière nue, la chaux, le bois
créosoté des lits superposés, le froid, la faim. Faire du livre une
cellule.
Lors de la publication d'Alecto !
près de quinze ans avaient
passé depuis que nous avions obliqué vers Prague,
laissant sur la gauche, au milieu des champs, la colline charbonneuse.
Dans une époque déjà
immémoriale, deux prisonniers SS avaient porté sur le bûcher le
corps de Desnos. On avait mis entre ses
bras croisés sur sa poitrine une branche
d’églantier en fleurs. Le feu, puis le vent, avait
emporté l’homme des sommeils.
Version finale ici (in Cabinet de Société (Henry, 2012)
Haut de page