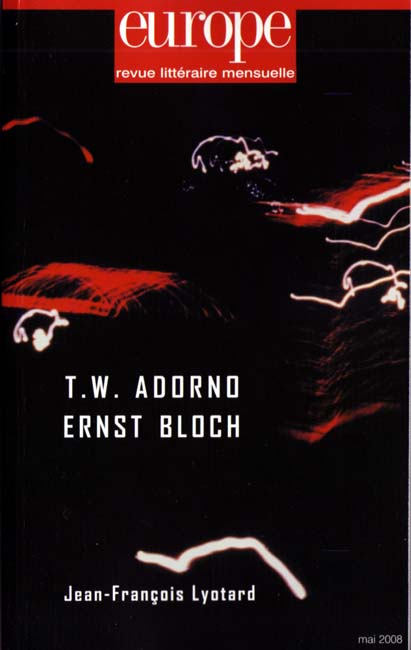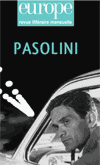|
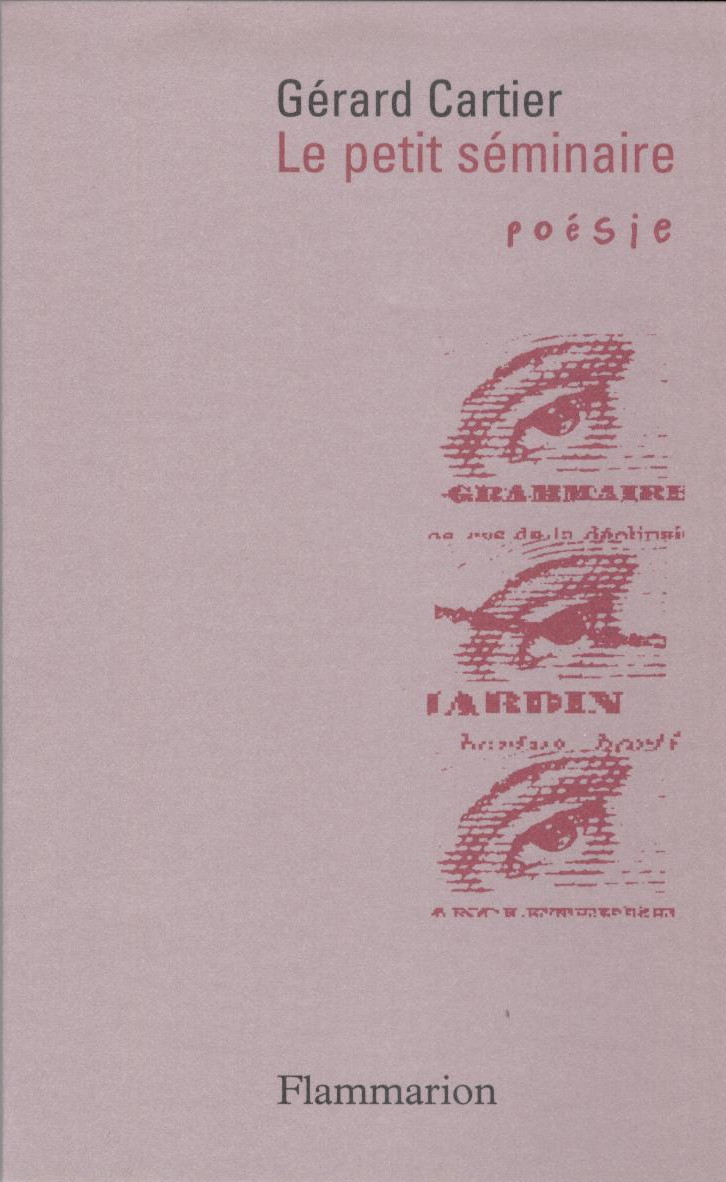 |
Le petit séminaire
(Flammarion, 2007)
|
|
|
Le petit
séminaire
rassemble de courtes proses autobiographiques. Trois lieux (Londres, la
chambre, le jardin de l’Étang)
témoignent pour
trois époques. Les textes sont marouflés de brefs
poèmes : voler
l'éphémère...
|
| |
|
1
Détroit du nord
(La ville)
|
|
(Les Mémoires)
Je veux aller modestement et épargner les circonstances. Si
c’étaient des pérégrinations
dans la Chine
de Mao ou les attentats de la rue des Rosiers : mais importuner le
siècle avec des contrats et le tumulte des
chantiers…
Qu’importent les dates et les lieux, la Chartreuse et les
mathématiques, et ce qui s’en suivit, des galeries
sous la
mer et des ports en Afrique, et le mince lot de livres qui ballote dans
mon havresac.
Si je regarde au-delà du détroit, si je dis je,
que l’on ne dise pas : Je vous y prends...
Ces engins qui comblent les marais, ce cimetière
abandonné sur la Tamise, ce bourdon qui soulève
un
instant la poussière, ce n’est que le hasard en
acte.
Celui qui demain, saisi d’un désir lunatique,
voudrait
recomposer ma vie, épluchant ce maigre viatique, en
tirerait-il
deux vérités ?
J’avance en effaçant ma trace. Qui croit me suivre
règle son compas sur les titubations de la lune. Je suis cet
être aux yeux bandés, punaisé au mur
au-dessus de
ma table, qui erre dans un labyrinthe de chambres et de cours, la main
ouverte devant lui, poursuivant en tâtonnant une ombre :
lui-même peut-être, qu’il cherche
vainement, le dos
tourné à une mer livide à force de
bleu et de
lumière.
Mon modèle sera L’Illustre du soir
de Paul
Louis Rossi. Ma vie n’y sera qu’une esquisse, une
forme
sans amidon flottant sur la feuille. La lumière et les
oiseaux
du ciel y feront leur partie, avec celle qui est parfois et
n’est
souvent qu’une illusion. On ne sait qui a
commencé, du peintre ou de la nature... Une liasse
d’images coloriées avec quoi cartomancier le
passé.
Ces saisons vives
qu’à
peine
tu as connues
oublie
pour encore
aimer
oublie
la
leçon
indiscrète
du passé...
Et quand je ne serai plus
qu’un roman, une terre inconnue – la plus
ordonnée du monde
– déployée dans le soir, où
une femme aux
mains tachées de pigments passera sous un masque, ce sera
beaucoup si l’on peut entrevoir ce miracle
qui est l’objet de la peinture : que naisse de tout cela
celui que l’on aurait pu être.
(La mort)
Que la mort n’y entre pas. Ni la disparition
d’Alice,
enlevée par un ange à Vinay, au milieu des
œillets
et des pois, ni ce jeune homme qui s’effondre sous la falaise
des
Écouges, dans l’ombre du Vercors, le visage
rongé
par les hyposulfites, dont je porte le nom.
Ils mettaient un crâne au coin de leur pupitre,
récitaient
un psaume, les yeux fermés, le corps raidi devant la planche
grossière qui demain les enfermerait, puis ils se jetaient
sur
leurs paperasses et sans la déguiser nommaient
l’ultime
compagne : leur gloire était de regarder sans ciller le peu
d’os et de poudre qu’ils seraient bientôt.
Je n’ai pas leur vertu. J’ai fait ma cellule
d’un
rêve insistant. Je suis ce simple d’esprit, ce cheminot
des premiers livres, ivre de vent et de mauvais vin, qui erre loin des
tombes de sa parentèle, pillant les vergers, courtisant des
femmes trop belles, se moquant qu’on le moque, le dernier des
apprentis de Bashô : Les cigales vont mourir Mais
leur cri n’en dit rien.
L’âge vient, je parcours encore le monde, la jambe
boiteuse, les yeux brûlés, louant la
lumière et la
beauté. Tout m’enseigne, tout m’est
contentement.
Les collines de Richmond s’évaporent dans le soir
: je
touche du pied le ciel. Un faubourg ingrat loin du fleuve,
enfermé dans le salpêtre : je consens. Une femme
qui
passe, défendue par un peu de couleur : c’est
elle, sous
ce visage étranger, c’est elle pourtant.
Demain, ayant épuisé les plaisirs, je me
retirerai dans
mon loculus. La mort n’y atteindra pas. Chaste comme un saint
de
Thulé, j’y louangerai l’hiver. Mais
qu’une
lueur traverse mon volet – un œil brûlant
dans le
ciel du nord ou une chevelure de glace – je bredouillerai
encore
un nom, qui peut-être sera mensonger et peut-être
véritable. Telle qu’au premier jour
où j’aperçus vos yeux...
En vain
a penché
la
lumière
et s’accroissent
les nombres
d’un geste
aveugle
celle
de toujours dans
la nuit
réinventer
...
(British Museum)
Leur lit est l’urne qui les renferme. Ils sont
allongés
sur le flanc, le buste dressé, un coude appuyé
sur le dur
oreiller, elle est devant lui, ses cheveux tressés en
couronne
sous un voile flottant, les yeux très grands –
comme pour
avaler en un instant le monde qui s’éloigne. Il
regarde
par-dessus son épaule, une assiette à la main
où
un œuf au plat est figé dans son or.
L’un fut enfermé d’abord sous la double
effigie.
À chaque anniversaire, l’autre est descendue au
pied de la
falaise, elle a lu au tympan du rocher l’inscription
familière et a déverrouillé la porte
de bois. Les
premiers temps, un intense remugle se répandait alors, la
repoussant sans compassion. Il a fait place peu à peu
à
ce fade relent de salpêtre et de cendres qu’elle
aime
à présent plus qu’un parfum.
La lumière tranche l’obscurité.
Là-bas,
accoudé dans un triangle ombreux, il a un bref instant
cligné des yeux. Elle renouvelle les gâteaux et
nettoie
les armes, puis s’assied sur la banquette de craie, au bord
du
mur voûté.
Ce qu’elle regarde, ce n’est pas ce visage plat
large comme
deux paumes, aux oreilles décollées, aux yeux
taillés dans des noix ; ce qu’elle entend, ce
n’est
pas la plainte éraillée qui
s’échappait au
dernier jour, si étrange dans ce corps massif, comme
d’un
enfant enfermé dans une statue d’argile. Elle se
regarde
telle qu’elle sera demain, elle écoute la
poussière
retomber sur sa tête.
Elle continuera pourtant à vivre là-haut, dans la
lumière des collines, souffrant encore la canicule et le
gel.
Elle feindra d’allumer le feu, de remplir d’eau la
bassine,
de tordre le cou des poules. Les nuits de fin de printemps, elle
sentira encore le désir la fendre. Ce ne sera
qu’une
dernière ruse, elle est déjà ici, dans
la nuit
perpétuelle, allongée près du cadavre
de
Chétré, sous la voûte où
cinq étoiles
la veillent, qui font tout l’alphabet :

Je pense à toi, un doigt sur
le couvercle,
traçant ton nom dans cette langue inversée, comme
si tu
n’étais plus. Je descends au fond de la combe
épineuse, je trébuche sur les marches
érodées, je te rejoins, un plat à
barbe à
la main, où roule l’œil d’un
taureau qui me
guide dans la nuit.
À genoux
dans les caves
griffonnant
une
épître
amoureuse
Chimère
aux ailes
déployées
la plume sur un
traité
d’une
langue
disparue...
(Le théâtre)
La lumière baisse. Le silence oscille comme une mer.
C’est
une cour nue découpée dans la nuit. Un maigre
vent y fait
imperceptiblement bouger des voiles. Une ombre blanche
s’avance
dans la pénombre, une voix murmure, que l’on ne
comprend
pas. C’est un chant mélancolique, une plainte.
Puis la lumière est droite. Une femme y titube,
gonflée
par un enfant monstrueux. Ses cheveux se répandent. Sa voix
sonde un paradis hors d’atteinte. Je la vois se consumer, les
yeux agrandis, la voix muable, immobile sur les planches,
brûlant
de cette flamme qui se nourrit du sang. Les gémissements,
les
louanges, les folles étreintes, écoutez : Que
le jour recommence et que le jour finisse…
Elle suit les leçons d’un
théâtre cruel. Rien
n’y est donné, sinon dans les larmes et la
souffrance.
Elle ne sait pas feindre. Là est son orgueil. La
Judée
est un désert, elle en éprouve le vent
brûlant,
l’inanité des jours voile ses yeux. Elle se
dessèche devant la mer vide, au sommet d’un palais
abandonné. Que tant de mers me séparent
de vous…
Ce n’était qu’un jeu – un jeu
terrible. Une
amie s’y ruinera, que nous verrons lentement se perdre, les
yeux
fixés dans le vide. Quoi si la réalité
ne peut pas
enfermer l’être, si une
vérité plus puissante
nous appelle, qui nous renverse au pied du pauvre monument de notre vie
? Il ne faut pas céder. Pas se donner à
l’inconnu.
Il faut écouter la rumeur de la rue qui filtre sous les
portes.
Regarder le soir bleuir dans la verrière au-dessus des
cintres.
Elle n’était pas de celles qui savent se
soustraire. Trop franche et trop légère. Ai-je
dit : Arrête
? Ai-je été ce régisseur qui ferme le
théâtre par crainte que
l’héroïne ne
succombe en scène ? Elle dit parfois : Autrefois...
et je détourne les yeux.
(6ème droite, porte  )
)
O
que revienne
le premier hiver
qui à
peine
se souvient
verse-lui
le
thé brûlant
broie
sur ta planche
poudreuse
les couleurs
...
Peins l’ombre
peins
la
lumière
pinceaux
entre les dents
puissante
comme
un dieu
peins la joie
lancinante...
Dans cet âge
où tout
se glace
où
n’est plus
la beauté
qu’une ombre
dans les livres
peins
l’âme
et le corps
à qui veut
aimer
encore...
(La chapelle des falaises)
Au fond des Cornoualles, errant sur les routes
gelées dans la vieille Ami 6. L’hiver
pénètre sous les vitres disjointes, le nez
renifle, les
mains rougies se cherchent par instants. Nous allons à
l’aventure, engoncés dans des manteaux barbares
–
une pelisse aux longues fibres hérissées et une
veste
afghane brodée de couleurs vives. Sans la vapeur d'essence
qui
flotte dans l'habitacle, ce serait la terre inconnue des premiers
missionnaires : un ciel aux eaux laiteuses, des collines
usées
comme des bornes miliaires, et la solitude bénie.
Un soir, au bout du désert, un bourg aux volets
tirés. Et
sur une pointe, à
l’extrémité des landes,
une vague ruine qui penche sur le vide. C’est le terme du
voyage,
la chapelle des falaises. Le ciel est à nos pieds. Il fait
sombre, le vent balance les herbes, des oiseaux noirs tombent sur la
mer. Un écureuil sautant d’ici Ne
guérirait pas de sa mort...
C’est au milieu du conte. Tristran franchit d’un
bond la
ruelle qui sépare son lit de celui de la reine. Sa blessure
s’ouvre dans l’effort, trois gouttes de sang
tombent sur la
farine qu’un traître a répandue entre
les lits. Les
amants sont pris et Tristran condamné au bûcher.
Passant
devant la chapelle, il demande à prier pour la
rémission
de ses péchés. Gode Sir pray ich...
On le délie, il bondit sur l’autel, ouvre
d’une main la fenêtre et saute dans le vide. Le
vent s’engouffre dans ses habits et le porte sur la mer.
La nuit venue, dans une auberge de jeunesse livrée aux
frimas et
aux vents coulis, nous dormons au milieu
d’étrangers,
séparés par une cloison mince comme un souffle.
À
minuit, frissonnant dans mon lit glacé, je saute dans le
sien
par la pensée, franchissant le grésil
répandu
entre nous : Ni vous sans moi Ni moi sans vous...
(Les louanges)
Ils élèvent des temples. Ils dressent des autels
où ils font la nuit brûler des parfums. Ils prient
et ils
macèrent. Ils écrivent sur des feuilles
légères que la plume déchire. Ils
louent, ils se
blessent, ils invoquent le vent et la fumée. Elle reste
distante. Ils lui donnent des noms inconnus des états-civils
et
la flattent sous un masque emprunté. Elle se moque mais les
laisse espérer. Ils se plaignent : Qui va
plutôt que la fumée... Elle les console
et s’échappe aussitôt. Plutôt
que la flamme, le vent ? Ils en remplissent des livres,
répétés de siècle en
siècle. Plutôt que le vent,
c’est la femme...
Puis ils brûlent tout, les Stances à
l’inconstance et la Défense de
l’infini.
Ils loueront désormais un visage imparfait et un nom
ordinaire.
Elle ne sera qu’elle-même, fragile et changeante,
non plus
cette statue de sel à l’implacable
beauté, mais
soumise au feu des années, lourde et fertile, protectrice,
grisonnante : Juliette, Mathilde, Elsa... Ils remontent longuement le
courant qui pourtant les emporte, regardant sans frémir le
ciel
qui s’assombrit. Puis leur vœu n’est plus
que
d’une tombe, une pierre sous un bouquet d’arbres
où
leurs noms se confondent :
Dormir du sommeil de tes
bras
Dans le pays sans nom sans éveil et sans rêves...
Je n’ai pas
brûlé ce qui
n’était pas elle. Et longtemps, feignant
d’aimer un
être plus parfait, je l’ai louée sous
des noms
frauduleux. Mais les années qui éliment les corps
et
gâtent les pages, les années ont passé
sans nous
user. Nous suivons sans nous hausser la trace de ceux qui ont fait tant
de bruit. Nous disons parfois leur nom, nous venons parfois
écouter sur leur tombe les oiseaux se plaindre et le vent
frotter sa corde dans les branches. Nous les envions, comme
d’autres, peut-être, nous envieront un jour,
rêvant
à leur tour devant le lieu de nous où
toute chose se dénoue...
| |
|
3
Au Monomotapa
(Le jardin)
|
|
(La Chine)
C’est un cercle de collines couronnées de
forêts. On
devine au loin, entre les bambous et les cerisiers, leur cime molle qui
s’évapore dans un lavis gris-bleu. Les nuages
s’étagent au-dessus, comme les montagnes perdues
où
courait le Mara. Plus bas sur la pente, au milieu des cèdres
de
l’Himalaya, un toit effondré.
Nous sommes seuls dans notre ermitage. Le soir vient sans oiseaux et
sans mouches, un brouillard léger qui monte de la combe et
fait
vibrer les formes. Entre les arbres, parfois, l’aboi
d’un
chien ou une plainte inarticulée dont nous frissonnons sans
raison – un voyageur blessé, ou le cri
d’un singe ?
Une rumeur gonfle et s’éteint dans le vent
d’ouest
– l’autoroute, ou le grondement d’un
torrent
dévalant les rochers ? Un instant, malgré la
fatigue et
la jambe claudicante, un instant si loin.
Les montagnes bleues
inutile
suivre
le long Kiang
ensemble
à la brume
sur la terrasse
du sud...
Le civet de lièvre fini avec
les doigts, ayant
atteint la lie au fond du verre, je m’avance dans la nuit, le
corps lourd et l’esprit flottant. Une lune morte glisse entre
les
fils télégraphiques. J’y cherche le
lapin vivant
qu’un soir d’ivresse, ayant gravi la colline, y
avait
découvert notre consul – jurant et exultant,
dressé
sur ses sandales de bois au fond de l’Orient.
La colline vacille, c’est une barque sombre penchant au ras
du
ciel. Je tends la main vers le miroir terni qui dérive sur
l’eau, ridé par un vent léger, et
vacillant au
milieu des signes j’y déchiffre une
étrange figure.
Se peut-il que me soit accordé plus qu’au Shigin
Taïshi ? Que nul ne me dise : C’est le vin
! si j’y vois le visage d’un
noyé qui regrette et se plaint.
…là-bas
flottant
dans les roseaux
une lune
si pur
qu’on y lit
l’épitaphe
de Li
Po ...
(Le gui)
Un matin de décembre elle traîne la double
échelle
au pied d’un aubépin. Les herbes à
l’abandon
mouillent ses chevilles nues, les nuages flottent dans les arbres.
L’échelle dépliée en
grinçant,
appuyée à une branche folle, elle gravit de biais
les
échelons glissants. Le vent par instants fait pleuvoir les
grands arbres, l’échelle oscille et se
dérobe.
Là-haut, inaccessible, le gui chevelu, ses centaines
d’yeux globuleux luisant sur de minces rameaux,
traître et
tentateur comme la chevelure de la Méduse.
N’était-ce pas déjà dans le
poème ?
Je cherche en vain le livre. Elle n’a pas remis sur
l’étagère, à sa lettre, le
volume
éventré par la fréquentation, une
liasse de pages
volantes sous un reste de couverture, comme autant de recettes pour
apprêter le monde.
Elle est sur le dernier échelon, une main
accrochée aux
branches noires, un bras tendu vers le trésor
argenté qui
irradie dans l’ombre. L’arracher à
pleine main, sans
souci d’en préserver la fragile arborescence,
glisser plus
que descendre vers la terre ferme et rentrer en courant, comme
après un sombre forfait, en laissant
l’échelle
ballotter à chaque souffle du vent, c’est
l’affaire
d’un instant.
Je me souviens d’un rameau caché dans les
feuillages
d’un arbre touffu, au bord d’un
précipice que
l’on dévalait sans retour, sauf à
porter devant soi
ce léger viatique. Est-ce dans sa manière ?
L’enfer, ce sera aujourd’hui une salle de classe
où
trente adolescents arracheront un brin au bouquet glauque en
écoutant célébrer d’une
oreille distraite le
mimosa nordique.
Un rameau fendu, deux boules blanches sous une courte pousse, leur
seront l’occasion d’inépuisables
métaphores.
L’esprit transfuse malignement.
En était-il si éloigné ? Car six mois
plus tard,
tandis que d’autres dépouilleront un bouquet
d’œillets roses, la même voix
célèbrera
la culotte d’une fille jeune
déchirée à belles dents...
(La règle)
Je suis à Port-Royal dans le bureau de Pierre Nicole.
Au-dessous, le verger se couvre d’un duvet
blanc-rosé. Les
oiseaux y pépient sur les branches flexibles. Pommiers en
palmettes, bouquets d’iris, cassissiers... Le pinceau du
soleil
colorie les formes, précis et délicat comme celui
d’un naturaliste.
Entre les murs palissés est un microcosme où les
éléments s’offrent purs de toute
disgrâce :
la qualité s’augmente du peu de
quantité. Un vent
grêle fait frissonner les feuilles – celui qui
brasse le
sommet des forêts. Et l’être qui chante
sur la vigne
est frère de celui qui regarde, appuyé
à
l’allège de sa fenêtre.
Les chartreux eux aussi, tout nourris de prière et de
silence,
ont chacun leur enclos où condenser le monde. Fleurs brunes
sous
la neige, fruits graineux, légumes dentelés
s’épousent dans des carrés de planches,
au pied de
trois murs que le regard ne peut passer. Retourner la terre. Chasser la
pensée. Apprendre et admirer. Travail de la main gauche, que
la
droite poursuivra à la tombée du jour, serrant un
crayon
à la pointe mouillée.
L’équerre
tout le jour
d’un
jardin sauvage
rectifier
la création
puis un mètre
court
mesurer
dans la nuit le
Grand Tout...
Je suis à Port-Royal dans le
bureau
d’Angélique Arnault. Derrière moi,
pendue au mur,
une peinture aux gris austères où une femme sans
âge regarde le monde s’apaiser dans le rectangle de
la
fenêtre. Où porte son regard, je vois les contours
se
mêler et se recomposer le chaos originel. Chemins boueux,
prés penchés, labyrinthes touffus où
l’œil que n’aiguise pas la
grâce ne sait plus
rien saisir – ni ce qui l’enchantait ni ce qui
l’enseignait.
Critiques
|
|
|
|
|
|
|
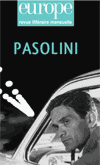
|
C'est
le poème en prose qui commande la narration, une authentique
narration, tenue comme un journal intime, trouée par des
inclusions de vers transparents et denses comme des tessons de
haïkus. (...) La description est en l'occurrence comme un
hévéa qui libère la sève,
la poésie,
prise au pied de la lettre, au cœur de l'être.
Gérard Cartier en appelle à Démocrite,
à
Lucrèce : "Une poésie qui
perçait l'opacité du monde". (...) Le
Petit Séminaire
s'ouvre en grand sur les jardins de l'univers, les visibles et les
cachés, et c'est par leur foisonnement que
l'écriture si
juste du poète nous touche à vif, comme si chaque
mot se
faisait l'épiphanie d'un nouveau savoir.
Charles Dobzynski
(Europe n°947 - mars 2008)
|
|
|
|
|
|
|
Haut de page
|

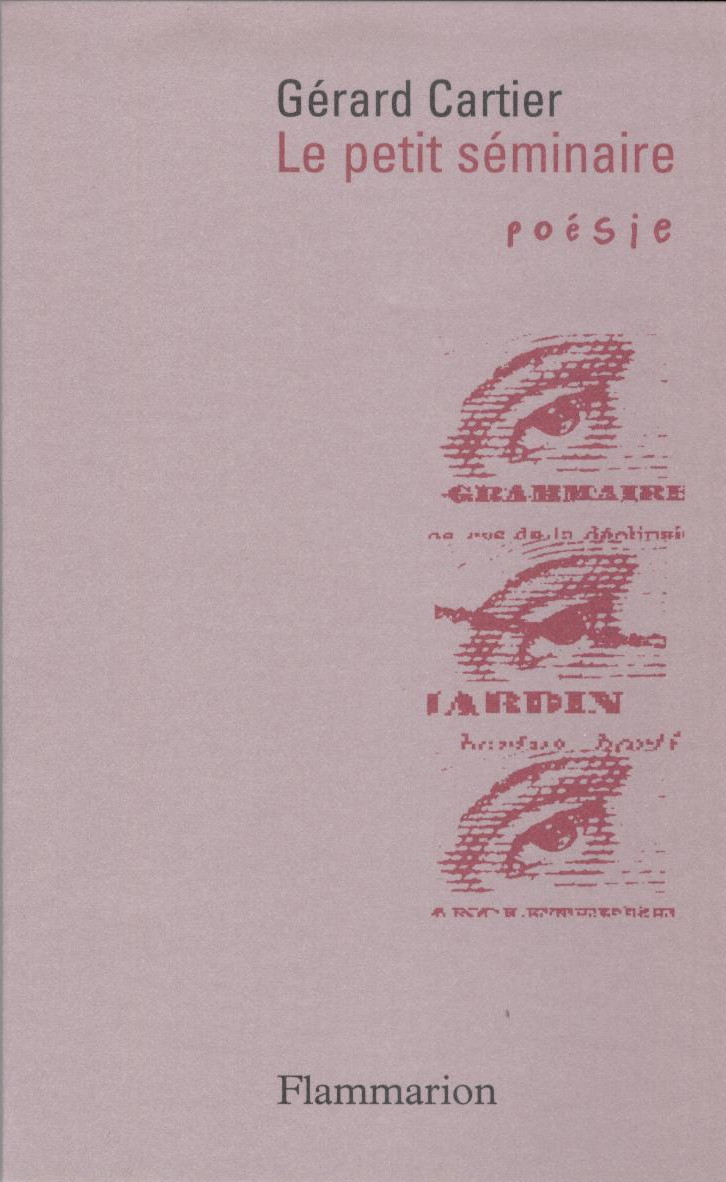



 )
)