
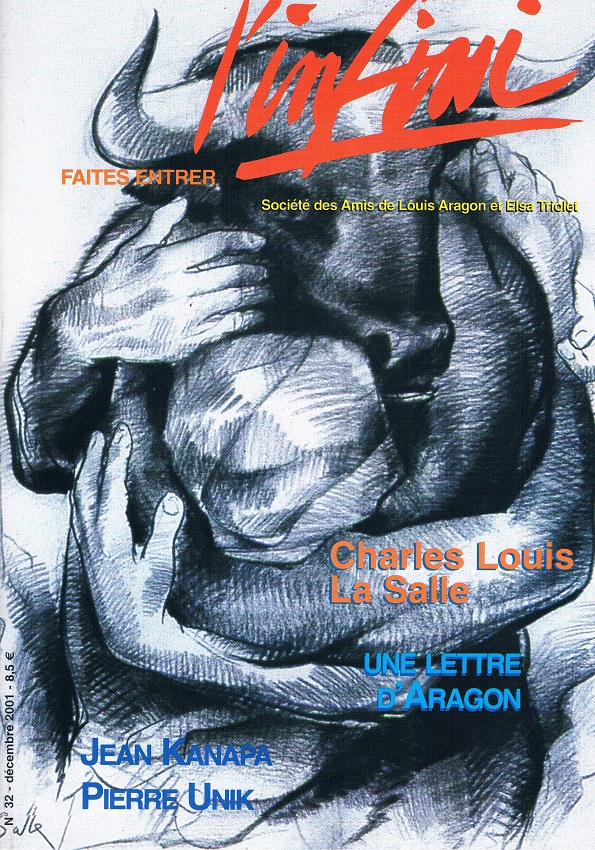
Pierre parmi les pierres
Ce n'était qu'un nom. Deux syllabes
étrangères, mais si familières, comme d'un gamin
taquin et orgueilleux s'affublant d'un pseudonyme avant de se
mêler à nous. Avant même que nous sachions rien de
lui, il était parmi nous comme une étoile impossible. Je
m'étais arrêté là. Qu'en serait-il s'il se
fût appelé Legrand ou Cartier ?
Il ne reste de lui qu'un livre unique. Un léger volume de toile
à l'enseigne d'une femme poisson. Cent courtes pages, rendues au
jour longtemps après qu'il eut disparu. Comme on ouvre la malle
d'un aïeul pour en exhumer, enfouie sous les habits
démodés et les albums aux photographies
gélatineuses, une liasse enveloppée dans un grand papier
bleu fermé d'une ficelle, que l'on dénoue
fébrilement.
Il était de ces temps engendrés par
la guerre dont nous avons perdu la mémoire. Sur de vieilles
images, des collines mâchées et remâchées
dont ne subsiste que le spectre : vagues moignons carbonisés ce
qui fut une forêt, boue et tranchées les champs et les
pâtures. Une glaise noire et suante, longuement pétrie,
à quoi il semble que rien ne pourra plus insuffler la vie.
Dernier avatar d'un monde condamné, dans lequel tout avait paru
sombrer.
Comment s'étonner qu'aux jeunes gens qui
en émergèrent bouillonnât le sang, que
leur cœur fût rempli de la plus grande colère, de la plus
grande liberté. Il fut de ces talibans qui brisent les statues
ancestrales et mettent le feu aux icônes. Il fut le
douzième apôtre, le plus jeune, celui que l'on assied en
bout de table et qui fait sa gloire des miettes du repas. Il fut aussi
celui que l'on donne aux basses besognes. Il est de beaucoup des rixes
de cette époque. Il gifle Artaud dans un couloir d'hôtel
pour une obscure querelle où les mots faisaient tout... Qui se
souvient de ce qu'il était à 20 ans, peut-il le
blâmer ?
Toi Pierre enfant qui partagea le pain de nos folies
À peine sorti de l'enfance, il se jette dans ce maelström. Dans les quelques poèmes de ces années, libres rêveries où la main court et précède la pensée, affleure un monde naïf de châteaux, de souterrains, hanté de cimiers et de baudriers, résonnant de batailles, vertes images d'une enfance arthurienne. Parfois, malgré lui peut-être, sous la plume que se fraie un chemin dans cette jungle, surgissent des images subliminales : celles d'une incompréhensible guerre, d'un terrible jugement, où l'on arrache « aux gouffres de la terre les sueurs des bêtes agonisantes... » Parfois, il atteint à l'esprit géométrique des peintures métaphysiques de Chirico :
C'est plus beau que la couleur de ce gant oublié sur la mer
et dans les sillons désertiques je ne trouve plus rien
mais là-bas les instruments de musique se rejoignent
dans une alcôve [...]
Sept années d'une règle fiévreuse. Déblayer les décombres de l'ancienne morale. Réinventer le monde. Rendre vie au « corps exsangue » de la poésie – non par des moyens formels, mais par les forces cachées et le dérèglement des sens. Il est de ces apostats frappés, au nom de la vérité, par l'interdiction de représenter l'ancienne beauté – une humeur qui s'écoulait malignement, « comme un filet de sang s'échappant malgré lui du corps du poète ». Il écrit peu. Souffre-t-il de l'intransigeante loi qui sépare du monde ses compagnons ? Il rejoint au grand jour le parti communiste. Il lui faudra bientôt choisir entre deux engagements, deux hommes, deux règles.
Toi Pierre mon compagnon de la plus difficile minute...
Il découvre peu à peu qu'il tournait le dos à la
vie. Il devine qu'il appartenait encore, malgré lui, à ce
peuple artificiel qu'il avait si longuement décrié, qui
« ne semblait pas vivre dans un monde peuplé de
commerçants et de soldats, d'ouvriers et de banquiers... »
Il dénonce dans la poésie moderne « une convention
nouvelle : celle de l'irresponsabilité ».
Il espère à son tour « l'idylle rouge de demain ». Il écrit pour L'Humanité, pour Commune.
Il est devenu ce « messager plus rouge que l'iris noir » de
l'un de ses premiers poèmes. Il fait l'éloge de Hourra l'Oural ! Il mêle à ses vers les épigrammes et les slogans militants :
Pourquoi ne pas chanter la guerre
les communistes ont découvert
il faut des actes héroïques
le chemin de la liberté
les champs sont aussi beaux couverts
chemin qui passe
de sang que de coquelicots
par la dictature du prolétariat
Il tente de tisser deux fils disparates. Sa prosodie se fait plus lâche, le vocabulaire plus simple et plus familier, le rythme libre et vagabond, dans l'accumulation des termes, des liaisons, et l'on pense à celui qui commence alors à écrire Paroles :
pour nos femmes et nos poètes et nos rues
et nos oiseaux et nos prêtres
pour nos maisons
pour notre soir
si doux [...]
Il se donne à d'autres tâches, le cinéma, le journalisme. Il n'écrit presque plus. Peut-on le dire poète ? Un poème par an, où le spectre de la guerre (la précédente, ou la prochaine) grandit à nouveau, dessinée d'abord comme en filigrane – puis c'est la matière même du poème, et nous ne sommes pourtant qu'en août 35 :
Voici la guerre comme hier
mes amis qui êtes en vie
voici l'Éthiopie le Brenner
choisissez la mort ou la vie
Mussolini Laval Hitler
Les années ont passé comme un souffle et rien n'a pu empêcher ce que l'on sentait obscurément venir. À présent il est aux avant-postes, en Lorraine. Il dit le froid terrible, et le vent, et la neige. Nous qui savons la fin du roman, qui gardons en mémoire la dernière scène, nous déchiffrons sous ses mots un autre récit. Comme sur un palimpseste où les lettres effacées, recouvertes par l'encre et les images, ne diraient pas le passé, mais l'avenir. Je ne lis que d'un œil – l'autre est tourné vers l'est, une montagne de fer ensevelie sous des neiges puissantes :
il y a les champs de neige...
la nuit près des chevaux
qui dorment debout
comme nous...
– et poursuis deux pensées. Parfois, par bribes, les deux récits coïncident et tout semble alors s'éclairer : le pain qui ne dégèle pas... Comme si, sous le motif des circonstances, affleuraient les lambeaux d'un récit prophétique, dont le hasard laisse parfois filtrer quelques mots, quelques vers. L'an quarante est ce poème démaillé sur lequel l'esprit mime le travail du temps :
il y a les champs de neige...
De Robert Desnos, on ne retrouvera rien. De Pierre Unik, une
poignée de vers. Dix poèmes sur un maigre cahier qu'il
envoie du Stalag, au milieu de l'hiver 45, au « Comité de
Sauvegarde des œuvres de la pensée et de l'art crées en
captivité ». Puis, ayant écrit une préface
où il dit sa foi dans le monde merveilleux de demain, il
s'évade pour toujours.
Et nous voici de ceux qui, comme il le prévoyait, « parlent au
passé sur un mode attendri ». Penchés sur ces vers
où une âme en sursis évoque l'avenir, y cherchant quelque pressentiment, qu'en effet nous ne
manquons pas d'y trouver, tant les circonstances le voulaient, et
tant nous y mettons de zèle :
Chaque mot de chaque être est déjà testament
ou encore :
L'âge juste ayant atteint sans trop d'illusion
Où Dante voulait voir le milieu de la vie
Il retrouve la métrique traditionnelle. Il retrouve les mots des jeunes gens ouvrant leur premier cahier, les images élémentaires : le temps, la lumière et la nuit. La vie. Il n'y donne à voir que peu de choses de ce monde où le premier devoir était de survivre. Parfois, la silhouette d'hommes muets, trébuchants, en haillons... Un chemin noir menant à l'usine. Une brève image, entrevue dans l'entrebâillement d'une porte de fer aussitôt refermée :
Sauvage galop des machines,
Odeur du lin fadeur mouillée
Et les paupières enfantines
Des filles travaillant nu pied.
Il est à Schmiedberg, dans des ateliers de tissage. Peut-être retrouve-t-il par instants les odeurs de l'enfance, peut-être revoit-il ce tailleur juif exilé de Pologne dont il fut le fils. Il est là, il n'y est pas, il lutte pour saisir sa pensée, il est dans la cage d'un monte-charge, ses yeux sont tournés vers l'intérieur : ...et j'oubliais / Mes lourds chariots pleins de bobines... La mémoire saigne. Les images du passé coagulent. Il évoque un pays sensible, à jamais perdu :
O mon pays ! c'était bien vrai que je t'aimais
Comme on aime une femme
Il retrouve dans un éclair les prestiges de la vie. Il revoit des rues éclatantes, les filles des cafés, les boulevards comme des mots d'amour, Madeleine, Opéra, boulevards de Paris... Il revoit Josie.
La mousse sous tes pas ton genou écorché
Les rires Les buissons pleins d'insectes dorés
Il voit la mort. Une rue où l'on vend des
funérailles. Gartenstrasse. Les boîtes qui leur sont
destinées, qui resserviront à d'autres, après eux.
Il dit : Je n'aurais jamais cru la mort si familière.
Qu'importe que ses vers soient trop souvent d'un modeste poète ? Que
trop peu de fièvre, de singularité, nous fasse regretter,
au nom du désir que nous avons de l'aimer, pour la souffrance
traversée et pour sa fin mystérieuse, nous fasse regretter
notre déception, comme si elle venait d'une dureté de
cœur. Les conventions ordinaires, la nuit et la lumière. Celles
que beaucoup ont alors retrouvées, et lui aussi, pourtant
séparé de tous par une frontière infranchissable ;
celles qu'il n'eut pas la force de magnifier, brisé comme il
l'était, seul et nu et misérable.
Mais que valent les mots, devant le corps qui espère et qui souffre, et qui rêve encore ?
Au début de l'année 45, alors que partout les
nazis
reculent et qu'à l'est un grondement sourd grandit, il
décide de prendre en main son destin. Il regarde vers cette aube
qui se lève, si proche, comme à un jet de pierre.
Maintenant, maintenant il faudrait s'attacher à ses pas. Il quitte
Schmiedeburg et s'enfonce dans les montagnes glacées. Le
camarade
qui l'accompagne, renonçant devant le terrible désert qui
s'ouvre, regagne bientôt le Stalag. Lui, il poursuit seul,
traverse des combes, des forêts. Je le vois, égaré,
se guidant sur une fausse étoile. Parfois, tout près,
l'aboiement des chiens d'une patrouille allemande battant la montagne.
Parfois des escadrilles, qui tracent une ligne incertaine,
très haut dans le ciel. Le froid qui s'insinue. Les membres
raidis, les mains gercées, les pieds glacés dans ses
méchantes chaussures. La faim qui se partage un morceau de pain
gelé. Et le traître sommeil, à quoi enfin il ne
résiste plus. Je le vois, les cheveux blancs dans la
dernière neige.
La page dit Slovaquie, mais je lisais Slovénie, obstinément – et la neige qui le recouvrait en
était plus terrible. De ce pays, je ne sais rien. Venant de Prague, nous n'avions
pas franchi la frontière. Ce n'était qu'un trait
hésitant sur une carte, dans un salon étroit, à l'étage
d'un HLM socialiste. Nous échangions les mots de trois langues
enchevêtrées, devant une tasse de café
brûlé, tandis que des hommes s'affairaient en bas sur
notre voiture. Nous nous tenions sur ce bord. Je rêvais d'un
autre de ses compagnons de misère.
Le printemps de Slovaquie, qui déchaîne ses torrents et se
hérisse de couleurs, ne le rendra pas. Il nous faut
pénétrer sans guide dans ces Carpates froides, un paysage
rebelle gravé au noir, composé d'instinct, de vagues
images devant soi, celles des Erz Gebirge ou du désert de
Chartreuse. Approcher à l'aveugle de ce lieu où tout finit,
remâchant une vision imprimée vingt ans plus tôt :
Je suis presque éteint couvert de cendres
dans les ruisseaux de l'orient...
Tchécoslovaquie,
après tout ce temps revenir vers toi, qui engloutissait nos
poètes, avant que la malédiction ne t'emporte à
ton tour...
La malle est ouverte, les vêtements poussiéreux
répandus, les livres et les photos poisseuses, le verrou secret
est tiré, qui fermait le double fond. Les feuillets
élimés, troués çà et là par
les
insectes des saisons, sont dépliés sur le plancher. C'est
un maigre trésor, qu'un souffle va disperser. Qu'en serait-il si
les neiges l'avaient relâché, lui qui n'avait encore que
l'âge du milieu ? Mais il ne devait être que par les mots
d'un autre :
Mais toi Pierre je te vois parmi les pierres
Tes cheveux noirs tes yeux ta barbe poussée...
[ici avec quelques légères corrections]
Version courte in Cabinet de Société (Henry, 2012)
Haut de page